Jacques GOFFINET (1730-1813), commis des affaires étrangères
par R. Péterlongo
Télécharger l’article en pdf
De Gy à Vienne
Jacques Goffinet est né à Gy, où il a été baptisé le 10 juillet 1730. Actuellement en Haute-Saône, Gy est un village situé à un peu plus d’une trentaine de kilomètres de Besançon. Goffinet est issu d’une famille de juristes, notaires, procureur fiscaux ou avocats. Son père est qualifié dans les actes paroissiaux de docteur en droit ou d’avocat en Parlement.
Après la conquête française de la région en 1674, Louis XIV fit de Besançon le siège du Parlement et de l’université (au détriment de Dôle). C’est la grande ville la plus proche de Gy. Le château de Gy était d’ailleurs une résidence de l’archevêque. C’est peut-être à Besançon que Jacques Goffinet a fait ses études. Il est également possible qu’il les ait faites à Dijon ou à Strasbourg dont la faculté de droit est réputée et attire des étudiants français ou allemands[1]. L’hypothèse d’études faites à Strasbourg permettrait d’expliquer une partie de son parcours postérieur. Il aurait pu y apprendre l’allemand et surtout rencontrer des personnalités lui permettant d’être embauché à l’ambassade de Vienne, dès 1752, à l’âge de 22 ans. En effet une partie du personnel des ambassades et du secrétariat des affaires étrangères est passé par cette faculté de droit de Strasbourg.
Ce que l’on peut raconter de Jacques Goffinet ne peut réellement commencer qu’en Autriche. En effet, hormis son baptême, on ne trouve pas d’informations sur lui avant de le trouver à Vienne, en 1752, auprès du marquis de Hautefort, ambassadeur du roi de France auprès de l’impératrice Marie-Thérèse. Il y exerce des fonctions de commis. Les dépêches de l’ambassade, codées, sont écrites de sa main.
Il n’est pas certain qu’il ait eu besoin de maîtriser parfaitement l’allemand. Vienne était moins grande que Paris (175 000 habitants au recensement de 1754 contre probablement plus de 500 000 à la même époque), mais au moins aussi cosmopolite[2]. A la cour on parle le dialecte viennois, mais aussi italien et français. Le français est la langue maternelle du duc de Lorraine François-Etienne, époux de l’impératrice Marie Thérèse, venu à la cour avec une communauté de Lorrains. C’est également la langue de correspondance de l’impératrice. Des troupes de théâtre trouvent un public suffisant pour se produire en français à la cour[3]. Le français est une marque de distinction sociale à Vienne. Le théâtre populaire est très révélateur. On se moque de celui qui maîtrise mal le français, comme on se moque aussi des Français réputés d’un raffinement exagéré.
La période qui s’étend du XVIIe siècle jusqu’au milieu du XIXe est un âge d’or pour les ambassadeurs. C’est une période au cours de laquelle les souverains ne se rencontrent pas. Pendant son long règne, Louis XIV ne rencontra qu’une fois son beau-père roi d’Espagne lors des préparatifs de son mariage sur la fameuse île des faisans au milieu de la Bidassoa, la rivière qui sépare les deux royaumes.
Les ambassadeurs jouent des rôles politiques majeurs. La majorité des ambassadeurs ne deviennent pas ministres, mais il est fréquent de voir des ministres commencer leur carrière comme ambassadeurs. On peut citer Choiseul, Talleyrand, Chateaubriand pour les plus connus. Il en est de même à l’étranger : Kaunitz fut ambassadeur à Versailles avant d’être le principal ministre de Marie-Thérèse puis de Joseph II d’Autriche. Des personnages aussi considérables que Franklin, les présidents Jefferson et Monroe furent ambassadeur des États-Unis en France.
L’essentiel du grand renversement d’alliance de 1756 ne fut pas négocié à Vienne, mais à Versailles, ce n’est donc pas à l’ambassade que s’est principalement nouée la nouvelle alliance entre l’Autriche et la France, qui mit fin à une très longue lutte entre les Habsbourg et les Bourbon et qui mit en place un système méridional (France-Autriche-Espagne) face à un système septentrional (Angleterre-Prusse) selon les termes de l’époque.
On ne sait pas exactement quand Jacques Goffinet est revenu de Vienne, mais il paraît probable qu’il y soit resté pendant toute la durée de la guerre de sept ans (1756-1763). Il devait donc y être, par exemple, lors de la bataille de Prague en mai 1757, lorsque la victoire temporaire de la Prusse fit très peur à la cour autrichienne. On sait qu’il y était encore lors de l’ambassade des Choiseul. Le duc de Choiseul fut en effet ambassadeur à Vienne de 1757 à 1758, avant d’être nommé ministre des affaires étrangères notamment grâce au soutien de Mme de Pompadour. Puis il fit nommer son cousin le duc de Choiseul-Praslin pour lui succéder comme ambassadeur auprès de l’impératrice Marie-Thérèse de 1758 à 1761.
Jacques Goffinet serait donc resté une dizaine d’années à Vienne. Les ambassadeurs logeaient dans le somptueux palais Questenberg, grand bâtiment baroque qu’ils louaient[4] et qui sera encore la résidence de Talleyrand lors du congrès de Vienne de 1815. Ce palais accueille actuellement le ministère des finances d’Autriche.
L’ambassadeur devait par le luxe de sa table, par le charme de ses manières, par la somptuosité de ses équipages, par l’éclat de ses fêtes, éblouir le pays où il représentait son maître[5]. Les Choiseul ne sont pas en reste, même en pleine période de guerre. Les domestiques des ambassadeurs étaient nombreux, mais le personnel administratif en nombre assez faible. En étant auprès de Choiseul et Praslin, Goffinet a donc la chance de côtoyer les futurs hommes forts des années 1760.
Ce personnel administratif se chargeait notamment de répondre aux nombreuses enquêtes ordonnées par le Ministère. Par exemple, en 1759, le contrôleur général Bertin lança à travers toute l’Europe une enquête sur les systèmes fiscaux[6]. L’ambassade avait bien sûr un rôle de représentation, mais elle devait aussi fournir au ministère de nombreuses informations sur l’état du pays, ses mœurs, les découvertes scientifiques, etc…
Praslin suit le même chemin que son cousin: rentré à Paris, il reçoit le ministère des affaires étrangères en octobre 1761, alors que Choiseul est devenu le principal ministre du royaume. Jacques Goffinet rentre au service du secrétariat des affaires étrangères le 22 mars 1763, donc sous le ministère Praslin.
Le traité de Paris mettant fin à la guerre de sept ans a été signé le 1er février 1763. Il est probable que l’activité diplomatique est intense et la correspondance volumineuse. Les Choiseul recrutent et choisissent des proches: des Lorrains comme eux, et des gens qu’ils ont connu lors de leurs séjours à Vienne. Goffinet rentre au ministère à la même période que d’autres commis venant de Vienne, notamment son collègue Michel Gouget, qui était secrétaire du duc de Choiseul, et Conrad Gérard qui fut nommé premier commis en juillet 1766.
Le 8 avril 1766, Praslin rend à son cousin le ministère des Affaires étrangères, et reçoit celui de la marine. Les Choiseul restèrent au pouvoir jusqu’à leur disgrâce en décembre 1770, Louis XV prétendant ne pas vouloir la guerre de revanche contre l’Angleterre qu’ils avaient préparée en renforçant considérablement la marine.
Organisation du département des affaires étrangères
Si l’organisation et les dénominations ont pu varier, on peut tout de même dessiner un paysage théorique du ministère des affaires étrangères à la fin de l’ancien régime.
La politique étrangère est décidée au Conseil d’en haut (qui se tient, à l’étage, près de la chambre du roi), appelé aussi Conseil d’État qui se charge aussi des affaires navales et militaires. Le ministre des affaires étrangères y siège et il est un des principaux ministres, voire le principal (Choiseul, Vergennes).
Il dirige un certain nombre de bureaux, à la tête desquels on trouve des « premiers commis », pour certains nommés « secrétaires du Conseil d’Etat » sous Louis XVI. Il y a deux bureaux d’expédition politique (trois à certaines périodes), chacun chargé de la correspondance avec un certain nombre de pays. La répartition est à peu près celle-ci: un bureau se charge des pays du nord et un autre se charge des pays du sud. Il y a également un bureau des archives et un bureau des fonds chargé des finances du ministère.
On aurait tort d’y voir un âge d’or de la rationalité administrative. C’est le bureau des fonds qui s’occupe de délivrer les passeports. Les consulats ne dépendent pas du ministère des affaires étrangères, mais de celui de la guerre. Enfin, sous l’ancien régime il n’y a pas de ministère de l’intérieur; les ministres se partagent donc les provinces, et celui des affaires étrangères peut être amené à les administrer.
Dans chaque bureau on compte un nombre variable de commis. Quatorze commis dans trois bureaux politiques en 1758, dix-neuf dans deux bureaux en 1766, seize en 1773, dix-huit en 1789. La taille du ministère est celle qu’a de nos jours l’administration d’une petite collectivité locale.
Il y a une hiérarchie parmi les commis. Certains sont nommés commis principaux. D’autres ont des statuts particuliers comme jurisconsulte, ou secrétaire du ministre. Des cartographes et des interprètes, parfois assez nombreux pour constituer un bureau, complètent le ministère. Il y a un doyen des commis, et même un vice-doyen. Tous ces titres et ces particularités donnent droit à un traitement plus important ou des gratifications supplémentaires.
Pour être exhaustif : il y a aussi des « garçons de bureau » chargés notamment d’allumer lumières et feux lorsque les commis arrivent, des ingénieurs géographes, un chirurgien, des gardes suisses et des « garçons frotteurs » qui dépendent du ministère.
Ces employés n’ont pas acheté de charges. Ils ont certains des caractères de la fonction publique moderne. Les employés de même grade sont classés par ancienneté, et leur rémunération augmente régulièrement. Elle est à peu près assurée même en cas de départ. Ils font généralement toute leur carrière au sein du ministère, puis touchent une pension.
Il n’y avait pas de règles écrites pour l’avancement ni pour les pensions de retraite: Néanmoins les commis étaient à peu près assurés d’avoir une progression de leur traitement et une pension à peu près proportionnée à celui-ci quand ils partent. Cette pension est une faveur du roi, qui est le plus souvent réversible à l’épouse survivante, voire aux enfants. Elle dépend des services rendus et de la situation de famille. Le nombre des pensions du ministère des affaires étrangères est à proportion du nombre des employés. Un très faible nombre de pensions en sont issus par rapport au nombre de militaires: en 1789 il y a 18000 bénéficiaires invalides pour la seule marine[7]. Les dénominations ne sont pas rigoureuses: certains employés continuent à toucher un traitement « maintenu » qui n’est pas mentionné comme pension dans les états de dépense.
En cas de maladie, leur traitement est maintenu, avec même parfois des gratifications. Le ministre pouvait faire preuve de munificence. Vergennes écrivit à un commis malade en 1783: « le temps des maladies étant le plus onéreux, ce ne sera jamais celui que je choisirai pour diminuer les appointements. »[8] L’ambiance de travail devait être assez bonne puisque ce commis voulait partager sa gratification avec ses collègues.
Voici ce qu’écrit Hennin qui fut premier commis de 1779 à 1792 sur le recrutement des commis: Les secrétaires du Conseil d’État (c’est à dire les premiers commis des bureaux politiques) et les deux autres chefs de bureau ont le choix de leurs commis, parce qu’ils en répondent. « Ils doivent choisir des personnes ayant de l’éducation et des mœurs, Gentilshommes ou fils de gens d’un état honnête. »[9]
Ils ne rentrent donc pas par concours mais, comme presque tout avancement sous l’ancien régime, grâce à la protection d’une personnalité haut placée. Malgré ce qu’en dit Hennin, le premier commis ne semble pas totalement libre du choix de ses commis. Certains lui sont recommandés plus ou moins fortement. Les réseaux de clientèle sont souvent difficiles à reconstituer, les recommandations pouvaient être orales, et en tout cas ont laissé peu de traces. Mais elles existaient: lorsque Choiseul décide du renvoi de plusieurs commis en 1768, leur chef de bureau les pousse à « employer leurs protections pour tâcher de rentrer en grâce ». Certains commis sont des enfants d’anciens employés des affaires étrangères ou d’autres bureaux, mais c’est assez rare: il y a beaucoup de clientélisme et assez peu d’hérédité.
Goffinet rentre donc le 22 mars 1763 dans le premier bureau d’expédition politique, dit « Bureau du Nord », dirigé par le premier commis François de Bussy. Rien ne prouve qu’il soit connu de son supérieur direct, et de toute évidence c’est le duc de Choiseul-Praslin qu’il a connu à Vienne qui le nomme à cette place.
Les premiers commis, rarement nobles à leur entrée en fonction, étaient la plupart du temps anoblis. A partir du règne de Louis XV, un écart semble se creuser entre commis et premier commis. Aucun commis ne devient premier commis après 1724. Les montants des traitements du premier commis sont quatre à six fois supérieurs au commis le mieux rémunéré. Les actes paroissiaux ou notariaux tendent à montrer qu’ils n’avaient pas les mêmes fréquentations, les premiers commis fréquentent la haute noblesse, tandis que les commis fréquentent des commerçants de Versailles ou d’autres employés de la cour[10].
Les commis travaillent d’abord au château, dans une des ailes des ministres, qui donnent sur la cour d’honneur. Puis en 1761, Choiseul décide de l’édification d’un hôtel des Affaires étrangères et de la Marine, à côté de l’hôtel de la Guerre achevé deux ans auparavant, qui lui-même avait été bâti à côté du Grand Commun qui abritait les services de bouche, c’est à dire les cuisines et les tables des officiers qui servaient la cour. Tous ces bâtiments sont situés près de la cour d’honneur. Les expropriations et la construction sont promptement menées et l’hôtel est achevé dès avril 1763, à l’époque de l’embauche de Goffinet.
Choiseul est sans doute le dernier des grands ministres de l’ancien régime. Il dispose d’un très grand pouvoir que le roi lui laisse et il est d’une haute et ancienne noblesse. Or l’hôtel des affaires étrangères est destiné au travail administratif mais a aussi un usage d’apparat. Il est très richement décoré et Choiseul qui décide de la décoration, se met en valeur, notamment avec un tableau célébrant le succès de son ambassade à Rome. Le département des affaires étrangères dans lequel travaille Goffinet se situe au premier étage.
La cour a été choquée par l’incendie de la Grande Écurie de Versailles provoqué par le feu d’artifice tiré le 13 septembre 1751 à la naissance du duc de Bourgogne. Aussi pour parer les risques d’incendie, on emploie pour la édification de l’hôtel une technique de construction dite à voûtes plates (dites aujourd’hui voûtes sarrasines), sans bois de charpente, sans planchers à solives. Les voûtes de briques sont liées par du plâtre, et s’appuient sur des murs épais, joints par des tirants de fer. Cette innovation fait d’autant plus parler d’elle que dès le mois d’achèvement de l’hôtel, un incendie détruit à Paris le théâtre du Palais royal.
Lorsque la cour se déplace à Compiègne, les bureaux disposent également d’un hôtel des affaires étrangères. À Fontainebleau, les bureaux s’installent dans un appartement du château. Des chambres sont louées dans la ville pour les commis[11].
En quoi consistait le travail des commis ? Il consistait essentiellement en un travail de rédaction de correspondance, de documentation, et de cryptographie à l’aide de ce qu’on appelle à l’époque « le chiffre ». Hennin, ancien premier commis, décrit dans un style laborieux un travail qui pouvait l’être aussi:
« Les chefs de bureau, comme les commis, sont obligés d’être au bureau depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures après midi. Le soir il n’y vient que deux commis par bureau à moins d’un travail extraordinaire. Chaque jour, vers midi, un des courriers du ministre part pour porter les lettres du département à Paris; à deux heures celui qui était parti la veille rapporte celles qui sont arrivées à la poste de Paris. Après dîner[12], les secrétaires du ministre ouvrent ses lettres, excepté celles timbrées pour vous seul. S’il y a du chiffre, ils le portent au bureau. Ils mettent au-dessous de la date de chaque lettre le jour de son arrivée et si c’est par courrier ils en font mention au haut de la première page de chaque lettre ou mémoire; ils inscrivent le nom du secrétaire du Conseil d’État auquel elle doit être renvoyée. »[13]
« Vers les cinq heures le ministre entre dans son cabinet, lit les lettres, et ordonne le renvoy à chaque bureau. Le matin vers neuf heures, les deux secrétaires du Conseil sont appelés chez le ministre. Ils lui rapportent tous les papiers qu’il leur a renvoyés la veille et les lettres chiffrées. Ils prennent ses ordres pour les réponses aux affaires courantes. »
Les commis classaient les papiers:
« Les papiers sont divisés entre les commis de chaque bureau. Ils sont chargés chacun de garder et tenir en ordre ceux relatifs à trois ou quatre cours pour l’année courante et précédente. Tant qu’une affaire n’est pas terminée, ils tiennent dans des enveloppes séparées tous les papiers qui y ont rapport, rangent ces enveloppes par ordre alphabétique, de façon que lorsque le chef a à travailler sur un objet il trouve sur-le-champ tout ce qui y a rapport. Au bout de deux ans les papiers de chaque bureau sont remis par ordre de dates dans des cartons fermés, étiquetés du pays et de l’année, et de tems en tems on envoye au dépôt des affaires étrangères ces cartons de façon qu’il n’y a jamais dans les bureaux que les dix ou douze dernières années des correspondances sur chaque pays. Lorsque les commis ne sont pas occupés des expéditions, ils font des tables des correspondances. C’est la partie la plus pénible de leur travail mais aussi la plus utile. »
Il était d’une grande importance stratégique d’avoir une documentation facile à retrouver sur les pays étrangers. Voici ce qu’étaient ces tables de correspondances:
« À mesure que les dépêches ou autres papiers sont remis à chaque commis, il fait à la marge un précis de chaque article. Lorsqu’il n’a point d’exposition à faire, il porte chacun de ces précis dans un livre blanc divisé par les vingt-quatre lettres de l’alphabet, en ayant soin de bien placer ces nottes au mot principal auquel elles ont rapport. Par exemple, un Ministre en Russie a parlé dans sa dépêche des travaux du port de Kerson; on placera au mot Kerson: Kerson travaux du port, v. dépêches de M. ?. et la datte. Dans une autre dépêche, il parlera du nombre des habitants; on mettra Kerson habitants, leur nombre, v.. dépêches de M. N* et les dattes, et aussi des dépêches du ministre, des mémoires et nottes, en sorte que sur ce premier livre se trouve le dépouillement de tous les papiers, à mesure qu’ils arrivent, dans un ordre alphabétique imparfait. Quand l’année est révolue, le commis revoit toutes ses nottes, les vérifie, ajoute celles des pièces venues postérieurement, et transporte le tout dans un ordre alphabétique exact sur un grand livre. En sorte qu’il n’y a rien dans une correspondance qu’on ne retrouve facilement au mot principal, et que soit sur les affaires, soit sur les personnes, on a dans le moment un abrégé de tout ce qui a été dit et l’indication de la dépêche où est le passage qui en traite. »
Dans la population ce sont les travaux physiques qui dominent, mais l’administration n’a pas inventé les travaux de plume ennuyeux: que l’on pense aux copistes d’avant l’imprimerie. L’ennui est cependant à relativiser: un esprit curieux pouvait très certainement trouver intérêt à collecter une masse d’informations diverses sur les pays étrangers: géographie physique et humaine, usages et mœurs, étiquette et politique des cours, etc. Et ainsi comme le conseilla Montaigne sur la découverte de l’étranger : « rapporter principalement les humeurs de ces nations et leurs façons, et frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui. »
Le chiffre
Mais une partie essentielle du travail est ailleurs : le chiffre. Cela consiste à crypter la correspondance expédiée, en remplaçant chaque mot et ponctuation par un nombre ou un signe, et en faisant l’inverse pour décrypter. Sous Louis XIV, il était demandé aux ambassadeurs de chiffrer eux même leurs dépêches, puis l’augmentation du volume des correspondances leur fit adjoindre des commis. Au XVIIIe siècle, les ambassadeurs partent avec quatre chiffres. Le premier est réservé à la correspondance avec le département des affaires étrangères. Le deuxième sert en secours si l’on soupçonne que le premier a été intercepté. Un troisième sert à la correspondance avec les autres ambassadeurs, et un quatrième sert aux pièces jointes.
Voici par exemple les consignes transmises au marquis d’Hautefort, ambassadeur à Vienne : « Le marquis d’Hautefort entretiendra une correspondance suivie, mais sage et discrète, avec ceux des autres ministres du Roi en pays étrangers dont les avis pourront lui être utiles ou nécessaires, et il les informera de son côté de tout ce qu’il croira pouvoir contribuer à leur direction dans l’exécution des ordres du Roi. Il sera surtout important qu’il soit dans un commerce régulier de lettres avec le comte Desalleurs, ambassadeur du Roi à Constantinople, mais il faudra que dans les occasions où le marquis d’Hautefort aura des avis importants à lui faire passer il prenne les plus grandes précautions dans l’usage qu’il fera de son chiffre pour mettre ses lettres à l’abri du danger d’être interceptées.
On lui remet pour cet effet des tables de chiffres dont il ne fera usage que pour cette correspondance, le chiffre intitulé : Pour la dépêche ne devant jamais servir que pour les lettres de l’ambassadeur au Roi ou au ministre ayant le département des affaires étrangères.
On y joint un autre chiffre de réserve pour les cas où celui de la dépêche pourroit être soupçonné d’interception, ou pour les occasions qui demanderoient un surcroît de précaution pour la sûreté du secret. Enfin on ajoute un quatrième chiffre pour les pièces communiquées, et comme rien n’est plus essentiel que d’employer les chiffres avec la plus scrupuleuse exactitude et de manière à en prévenir l’interception, on y joint un mémoire instructif sur la manière de chiffrer. Le marquis d’Hautefort ordonnera au secrétaire auquel il accordera sa principale confiance, de se conformer littéralement et constamment aux règles prescrites par le mémoire. »[14]
Pourquoi un chiffre particulier pour les pièces jointes ? Parce que si jamais l’intercepteur avait un exemplaire en clair de la pièce jointe, il a alors une version cryptée et une version non cryptée du même texte, et il lui est donc facile de reconstituer le chiffre.
Cela se produisit par exemple en 1753 lorsqu’un résident de France en Pologne, La Fayardie, fit savoir à Versailles la mort de son secrétaire Thomelin, mystérieusement décédé à Varsovie. Il prévint dans une dépêche non cryptée que la prochaine contiendrait des éléments d’explication de ce décès. C’est ce qu’il fit : il joignit le rapport d’autopsie crypté dans sa dépêche. Or, si les casseurs de code prussiens ou anglais avaient pu se procurer l’original de ce rapport, ils auraient pu reconstituer le code et ainsi déchiffrer la dépêche et toutes celles qui par le passé avaient été chiffrées avec ce même code et dont ils avaient gardé copie. Le chef du bureau du chiffre à Versailles le comprit bien : il ordonna à La Fayardie de brûler son code et d’en utiliser un autre[15].
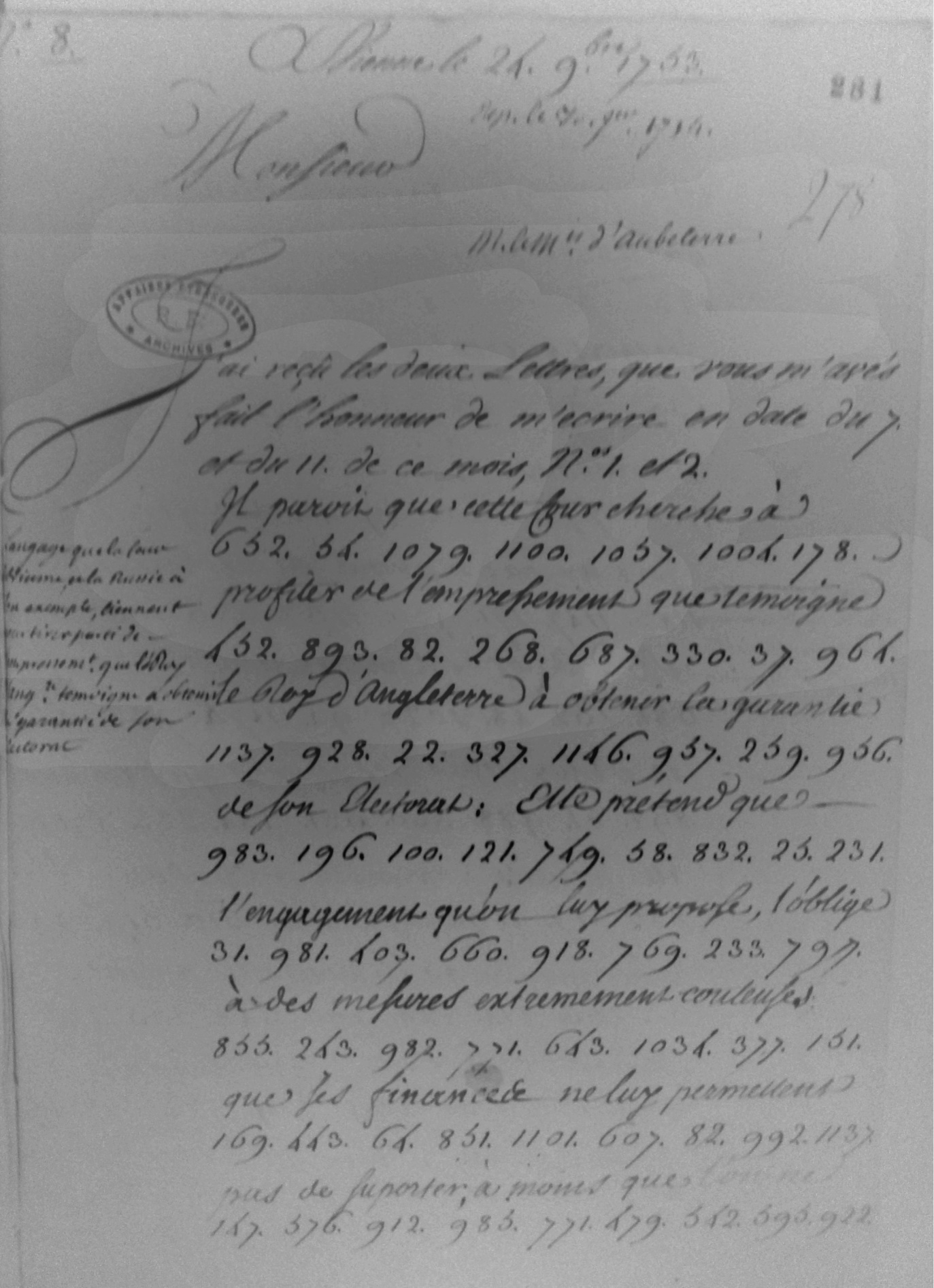
Lettre du marquis d’Aubeterre, ambassadeur à Vienne en 1754
Autre exemple d’erreur: un jour, une dépêche, également issue de Pologne, n’arriva pas à destination. Charles de Broglie, l’ambassadeur, en renvoya une copie en négligeant de chiffrer un post-scriptum qu’il jugeait sans intérêt. Funeste erreur ! Si la dépêche qui n’était pas arrivée à destination avait été gardée par des décrypteurs, il leur était alors possible de connaître le code grâce à la partie non chiffrée[16].
Les négligences humaines posaient donc problèmes. Le code devait fréquemment être changé, par précaution. Entre deux chiffrages et déchiffrages, les commis devaient fréquemment composer de nouvelles tables. Un règlement de Choiseul de septembre 1767 était destiné à éviter les fuites: « La garde des chiffres sera confiée à un seul commis. Il les tiendra sous clef et en sera responsable. Il ne les donnera aux autres commis que pour le moment du travail… »[17]
On se méfiait même de l’écriture des commis pour certaines combines secrètes. Voici ce que Vergennes, ministre des affaires étrangères de 1774 à 1787, écrivit à Louis XVI au sujet de l’aide à envoyer aux colonies américaines par l’intermédiaire de Beaumarchais, en mai 1776:
« Sire, j’ai l’honneur de mettre aux pieds de Votre majesté la feuille qui doit m’autoriser à fournir un million de livres pour le service des colonies anglaises, si elle daigne la revêtir de son approuvé. Je joins pareillement, sire, le projet de la réponse que je me propose de faire au sieur de Beaumarchais, si votre majesté l’approuve; je la supplie de vouloir bien me la renvoyer tout de suite. Elle ne partira pas écrire de ma main, ni même de celle d’aucun de mes commis ou secrétaires. J’y emploîrai celle de mon fils, qui ne peut être connue; et quoiqu’il ne soit que dans sa quinzième année, je puis répondre affirmativement de sa discrétion. Comme il importe que cette opération ne puisse être pénétrée, ou du moins imputée au gouvernement… »[18]
Si Hennin qualifiait la rédaction des tables de correspondance de partie la plus pénible du travail, le travail du chiffre ne devait pas être beaucoup plus exaltant. On peut imaginer que le caractère ludique de l’activité s’estompait avec la longueur de la correspondance. Les uns à côté des autres, les commis chiffrent et déchiffrent. Chacun s’aide en nommant le chiffre à voix haute et gêne son voisin chargé d’une rédaction[19].
Le baron Honoré Duveyrier (1753-1839), neveu de Joseph Nivelet qui fut le doyen des commis, est l’auteur d’une autobiographie dans laquelle il raconte les choix qu’il a eu à faire dans sa jeunesse. Il raconte qu’un jour un de ses oncles lui tint ce discours:
« Mon enfant, me dit-il, écoute-moi bien, ton père, ton oncle Nivelet et ton oncle Bouchard veulent disposer de toi à leur gré, et chacun d’eux veut te faire ce qu’il est. Ton père, qui n’a sur le dos que sa casaque militaire, entend se débarrasser de toi avec une lieutenance d’infanterie; ton oncle Nivelet, qui ne voit rien au delà d’un bureau diplomatique, espère que tu chiffreras toute ta vie à côté de lui ou à sa place… »[20]
Pour cet autre oncle, avocat libertin, il faut vivre et donc refuser la carrière militaire trop risquée du père. Mais il faut une vie plus aventureuse que celle de l’oncle commis. C’est l’exemple de l’oncle libertin que le jeune Honoré choisira, il devint un des avocats les plus en vue de son temps.
De 1749 à 1755 on expérimenta la création d’un bureau spécialisé du chiffre. Avant sa création, on comptait douze commis au total, six dans chaque division politique. On en prit huit, quatre dans chaque bureau, pour constituer le bureau du chiffre.
Le premier commis Bussy se plaignit que les deux commis qui lui restaient avaient trop de travail, et que le bureau du chiffre « ne fonctionnait que par accoup ». Si l’on tient compte de cette plainte, on peut déduire de la répartition des commis que le travail du chiffre devait représenter environ la moitié du temps de travail des commis des bureaux politiques quand ceux-ci furent chargés de nouveau du chiffre.
Travaillait-on vraiment beaucoup ? Il y eut plusieurs règlements fixant les horaires de travail; ce rappel peut laisser penser que les horaires n’étaient pas toujours scrupuleusement respectés. Généralement on ne réglemente que ce qui a besoin de l’être, mais ce n’est pas toujours le cas.
On trouve ces paragraphes écrits en 1751 dans le journal du marquis d’Argenson, qui fut ministre des affaires étrangères de 1744 à 1747:
« On ne fait absolument rien aux affaires étrangères; M de Puisieux ne songe qu’à sa santé et à faire sa cour, il est dès le matin à cheval dans la forêt et de toutes les chasses du Roi ainsi que de ses soupers. L’abbé de La Ville court matin et soir chez les grands et se montre partout à la Cour, le soir chez des femmes où il joue et soupe. Le sieur de Bussy, autre premier commis, donne des soupers fins jusqu’à cinq heures du matin; et les deux frères Le Dran qui ont la charge du dépôt des papiers, sont à la campagne des mois de suite, n’ayant rien à faire au monde car on ne leur demande rien. Les autres commis ne travaillent pas d’avantage, à peine répond-on trois lignes à chaque dépêche d’ambassadeur. M. de Puisieux est allé à Sillery passer trois jours allant à Compiègne. Ainsi l’on dit qu’il n’y a plus d’affaires étrangères, tant on y travaille peu. » [21]
Il rapporte que les commis lui chantaient a contrario les louanges de l’époque de son ministère:
« Nous formions des lettres longues, raisonnées et instructives qui dirigeaient la conduite de nos ministres aux cours étrangères. L’on peut dire que pendant vos deux années de ministère, il est sorti plus d’écritures que pendant six années de vos prédécesseurs ou successeurs et que les commis ont été moins fatigués de ce travail sous vous que d’une oisiveté inquiète et troublée sous les autres »[22]
Dans ses écrits politiques, le marquis d’Argenson se montre singulièrement partisan de l’abolition des privilèges et d’une sorte de démocratie municipale au sein de la monarchie. Ses ouvrages furent particulièrement appréciés par Rousseau. Mais, plus amateur d’utopie politique que fin dirigeant des hommes, il est assez médisant envers ses contemporains tout le long de son journal, et en 1751 il est surtout extrêmement mécontent d’avoir été écarté du ministère. A défaut d’être absolument fiable quant à l’assiduité à leur travail, son propos illustre ce qu’on pouvait dire ou médire de ces commis.
Cependant les commis, moins nombreux, sont aussi moins diffamés que certains officiers, propriétaires de leur office, ou que les mal-aimés collecteurs d’impôts de la Ferme générale. En règle générale, les commis ne se font pas remarquer. À l’époque on rit plutôt avec Chamfort de cette anecdote sur le Parlement de Paris. Un jour que quelques conseillers parlaient un peu trop haut à l’audience, le Premier Président M. de Harlay aurait eu ce bon mot : « Si ces Messieurs qui causent ne faisaient pas plus de bruit que ces Messieurs qui dorment, cela accommoderait fort ces Messieurs qui écoutent ».
On l’a vu, lorsque Goffinet est recruté en 1763, son chef est le premier commis François de Bussy. On doit dire un mot sur ce Bussy[23]. D’abord secrétaire dans différentes ambassades, il fut ministre plénipotentiaire à Londres de 1740 à 1744. Il a été prouvé (au XXe siècle) qu’il avait touché d’importantes sommes d’argent de la part de l’Angleterre, et livré des informations à la fin des années 1730. On ne sait pas si ces versements ont continué, mais il est assez troublant de noter que c’est lui qui en 1745 fut chargé de préparer des projets de débarquement en Angleterre ! Il fut premier commis de 1749 à 1766 (donc pendant toute la durée de la guerre de sept ans). Il mourut en 1780 après avoir bénéficié d’une généreuse pension de retraite. Tel était le premier chef de Goffinet.
Il fut remplacé comme premier commis par Conrad Gérard, qu’on a vu ancien secrétaire à Vienne de 1761 à 1766. Puis il fut lui-même remplacé en 1779 par son frère Joseph Gérard de Rayneval, qui resta premier commis jusqu’en 1792.
Jacques Goffinet a donc servi Louis XV puis Louis XVI, dans le 1er bureau chargé de « l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre, les Provinces-Unies des Pays-Bas, & les Etats unis de l’Amérique Septentrionale: les cours de Vienne, de Berlin, de Mayence, Coblentz, Bonn, Dresde, la Bavière, le Palatinat, Deux-Ponts, Stutgard, Cassel, Darmstadt, l’évêque de Basle, la Diète générale de l’Empire d’Allemagne; les cercles, Liège, Hambourg, Francfort-sur-le-Mein, & généralement tout l’Empire d’Allemagne, ainsi que les affaires de limites. »[24]
Ce service ne connut que deux petites interruptions. D’abord par une mission en Pologne au début de l’année 1764, puis pendant un an et trois mois, à la suite d’une réforme le 5 octobre 1767. A cette date, Choiseul, qui a remplacé son cousin, souhaite alléger le département dans lequel il y a eu un certain nombre de recrues. Il semble que l’on garde les plus anciens et que ce soient les nouveaux qui partent: Goffinet, son nouveau beau-père Joubain, et son collègue Gouget qui suit une carrière presque semblable à la sienne. Il n’est pas sûr que la motivation soit financière, puisque les commis semblent garder leur pension, et que le premier commis Gérard est augmenté à cette occasion. Peut-être était-ce dans un but de plus grand secret de la correspondance. On a vu que le règlement de Choiseul sur le secret des chiffres datait de septembre 1767.
Si telle était la motivation, ce ne fut pas un succès. En effet à la fin de l’année 1768, un soupçon nait à propos de l’interception du chiffre. Le consul de France à Pétersbourg prétend qu’il a appris l’interception des chiffres de la correspondance avec la Russie, et qu’un membre du personnel des affaires étrangères les a vendus au représentant russe en France.
Gérard, réputé autoritaire, fait des reproches à ses commis au nom du ministre. Le ton monte et les commis se sentent atteints dans leur honneur. Six d’entre eux écrivent un mémoire et se plaignent directement à Choiseul:
« Si la même attention, les mêmes précautions, et la même exactitude qu’on observe dans les bureaux étaient également observées par les Ambassadeurs et Ministres du roi dans les pays étrangers et dans leurs secrétaireries, on ose avancer qu’il serait de toute impossibilité d’intercepter leurs correspondances.
On peut dire que la plupart des Ministres du Roi dans les pays étrangers ne se sont jamais beaucoup occupés de l’importance des chiffres qu’ils regardent comme un mécanisme dont ils abandonnent la direction à leurs secrétaires qui n’en connaissent pas les conséquences, et qui partent ordinairement avec les Ministres qui les ont choisis, sans avoir pris aucune notion sur l’usage des chiffres.
Mais ce qui les affecte infiniment, ce sont les marques de défiance que Monseigneur leur a fait manifester d’une manière aussi affligeante pour eux. La réputation de leur probité et de leur discrétion s’est toujours soutenue, et leur a acquis en tout temps une considération bien méritée. En effet où trouvera-t-on en Europe une chancellerie des Affaires étrangères inaccessible à la corruption ? On ose avancer, sans crainte d’être démenti, que celle de France est la seule intacte.
Si les commis des affaires étrangères étaient susceptibles de corruption, ils seraient plus à leur aise qu’ils ne le sont, mais l’honneur tient lieu de tout aux Français; ce n’est point l’aspect de la Bastille ni la crainte du châtiment qui les retiennent dans leur devoir; les sentiments seuls que cet honneur inspire à chacun des membres des Affaires étrangères sont la boussole de toutes leurs actions.
Signé: Nivelet, Sablon, Lesseps, Lancel, Moreau, Le Duc »[25] (tous commis du 1er bureau)
Choiseul ne tolère pas ça. Le lendemain, il les reçoit et leur dit: « J’ai lu vos deux mémoires, vous pouvez avoir raison mais comme il ne vous convient pas de me donner des leçons, je vous renvoie tous six et si vous paraissez dans les bureaux, je vous ferai mettre aux cachots; vous êtes des insolents. »[26]
L’interdiction de reparaître ne doit pas surprendre, c’est là la manière de disgracier au XVIIIe siècle. Choiseul lui-même sera exilé deux ans plus tard par une lettre de cachet du roi rédigée en ces termes: « Mon cousin, le mécontentement que me causent vos services me force à vous exiler à Chanteloup, où vous vous rendrez dans vingt-quatre heures. »
Gerard doit reconstituer son bureau; c’est une aubaine pour Jacques Goffinet. En janvier 1769, il est rappelé en compagnie de Michel Gouget, et on recrute de nouveaux commis. Deux des commis renvoyés, Nivelet et Lesseps (de la famille de diplomates Lesseps dont le plus connu est Ferdinand) arriveront à faire jouer leurs protections pour revenir. Il semble que la volonté de Choiseul de ne pas confier la charge du chiffre à plusieurs commis ait perduré : Goffinet prétendra dans une lettre écrite pendant la Révolution que « pendant quarante-quatre ans de services sans interruptions dans le département, le citoyen Goffinet était seul chargé du chiffrement des dépêches de son département indépendamment des autres fonctions communes à tous les employés ».
Il y n’eut plus de bouleversements semblables dans les bureaux jusqu’à la fin de la monarchie. Les premiers commis restent à leur place de 1779 à 1792. Gerard de Rayneval dirige le premier bureau où travaille Goffinet, chargé de la correspondance avec l’Espagne, l’Angleterre, les Pays Bas, les États-Unis, l’Autriche et l’Allemagne ; Henin est dans le second bureau. Vergennes est ministre jusqu’à sa mort en 1787 puis il est remplacé par Montmorin.
Goffinet est recruté avec un traitement de 2000 livres. C’est une honnête rémunération sachant qu’un travailleur non qualifié gagne de 300 à 400 livres par an. Il gagne 2400 livres en 1771, 3000 en 1773, et son traitement montera jusqu’à 5900 en 1789.
À cela s’ajoute des gratifications annuelles, des indemnités de voyage lorsque la cour est à Compiègne ou Fontainebleau (600 livres par voyage). Ces indemnités devaient être largement distribuées: en 1775, un commis parvint à percevoir cette gratification sans avoir été du voyage, ce qui provoqua la fureur de Vergennes[27].
On aidait également les commis lors d’évènements particuliers: Goffinet reçoit 1500 livres en 1764 (peut-être pour sa mission en Pologne), et 1000 livres en 1765 pour son installation à Versailles. Il reçoit également 1320 livres pour son mariage en 1767. Il faut noter que lors de l’interruption de son service en 1768, son traitement est conservé.
On peut comparer ce traitement avec celui des autres employés: à partir de 1768 le premier commis Gérard gagnait 24.000 livres de traitement[28], et Nivelet le doyen du bureau en gagnait 4000. Les frères Gérard reçurent une gratification de 15.000 lors de leurs mariages en 1768 et 1776. En 1789, Goffinet est vice-doyen (le terme existait) de son bureau, et gagne 5.900 livres[29]. Le doyen Montcarel en gagne 8.300 et Gérard de Rayneval en gagne 32.000 (mais il a d’autres appointements). On voit encore dans les chiffres la distinction entre commis et premier commis.
On l’a dit, il n’y avait pas de règles écrites pour l’avancement ni pour les pensions de retraite. Néanmoins les commis étaient à peu près assurés d’avoir une progression de leur traitement et une pension à peu près proportionnée à celui-ci quand ils partent. Cette pension est une faveur du roi, qui est le plus souvent réversible à l’épouse survivante, voire aux enfants.
On aurait tort de trop imaginer Goffinet au sein d’une organisation qui serait une version monarchique de la fonction publique contemporaine. On a vu que le ministère était minuscule comparé à l’administration foisonnante de la fin du XXe siècle. Après tout, les « bullshit jobs » dont parle l’anthropologue David Graeber[30], ces emplois de « cocheurs de cases » ou de « larbins » qui de l’aveu même de ceux qui les occupent ne servent pas à grand-chose et que l’on trouve aujourd’hui au sein de l’administration et de tout le secteur tertiaire, ressemblent davantage au XVIIIe siècle aux offices vénaux. C’est là qu’on trouverait un foisonnement. L’imagination pour créer des offices eut peu de limites: dame d’atour, grand échanson ou pâtissier des chiens du roi…
Ce sont quoiqu’il en soit de très bonnes années pour le jeune comtois.
Le voyage en Pologne et le Secret
Le voyage que Jacques Goffinet fait en Pologne au cours de l’année 1764 mérite que l’on s’y attarde. Il est rare que des commis partent à l’étranger : la carrière des ambassades et celle du ministère sont deux carrières différentes.
Le contexte est celui-ci : la Pologne et la Lituanie forment la République des deux nations (Rzeczpospolita Obojga Narodów), avec un système institutionnel original. C’est une république sous la présidence d’un roi, mélange de monarchie élective, de république aristocratique et d’institutions inspirées de la Rome antique.
Le roi était élu par la Diète, l’assemblée des aristocrates du pays. La Diète choisissait souvent des monarques étrangers pour éviter que le roi ne fonde une dynastie (le roi de France Henri III fut le premier élu). Le roi élu ne disposait que peu de pouvoirs, car il devait respecter la constitution et le droit de veto dont disposait chaque membre de la Diète. Ce liberum veto permettait en effet n’importe à quel député de provoquer un arrêt immédiat de la session en cours et de reporter toutes les mesures précédemment abordées jusqu’à l’élection d’une nouvelle diète. Cette constitution rendait le pays difficilement gouvernable et très vulnérable aux immixtions étrangères. Toutes les puissances intervenaient: la Suède, l’Autriche, la France et dans la seconde moitié du XVIIIe surtout la Russie et la Prusse. Des factions étaient soutenues par telle ou telle puissance européenne ou en cherchaient le soutien militaire et financier.
C’est en vue de l’élection du roi de Pologne qu’avait été créé le fameux Secret du roi, un service diplomatique et de renseignement qui entretenait une correspondance parallèle à la correspondance officielle. Il permettait à Louis XV de communiquer avec certains de ses agents (ambassadeurs ou autres représentants à l’étranger) à l’insu de ses ministres. Le but initial était de préparer l’élection du prince de Conti (prince du Sang, cousin du roi), mais il s’agissait aussi de contrôler la politique ministérielle, voire parfois d’engager une politique différente.
Ainsi, en 1752, lorsque le comte de Broglie est nommé ambassadeur en Pologne, il reçoit un billet du roi: « Le comte de Broglie adjoutera foy à ce que lui dira M. le prince de Conty et n’en parlera à âme qui vive. » Le Secret sera ensuite dirigé par le comte de Broglie lui-même et par Tercier (premier commis de 1749 à 1759, qui dirigera le Secret même après avoir été disgracié).
Dès l’annonce de la mort du roi Auguste III le 5 octobre 1763, les différents camps s’organisent autour de leur candidat. Le candidat de la famillia, le clan de la puissante famille Czartoryski, est soutenu par la Russie et la Prusse. Il s’agit de Stanislas Poniatowski, qui est l’ancien amant de la tsarine Catherine II. L’autre puissante faction polonaise, le camp dit « républicain » ou des « patriotes » soutient Jan Klemens Branicki, grand hetman (qu’on peut traduire par grand-général) de la Couronne.
Au ministère des affaires étrangères, on pense au frère de la Dauphine, Xavier de Saxe, fils et petit-fils des rois précédents Auguste II et Auguste III. Au sein du Secret, on pense au prince de Conti mais plus sérieusement au même Xavier de Saxe. Louis XV écrit ainsi à Tercier: « Ce que je désire premièrement pour l’élection prochaine en Pologne, c’est la liberté des Polonois dans leur choix; ensuite un des frères de Madame la Dauphine, Xavier, préféré aux autres, l’aîné exclu de lui-même sans que nous y paraissions. S’ils prennent le prince de Conti, je ne m’y opposerai pas. »[31]
Les Russes préféraient un roi polonais car ils craignaient qu’un troisième roi de la dynastie de Saxe ne donne un caractère héréditaire à la monarchie polonaise (comme au Saint empire germanique devenu de facto héréditaire). Ils voulaient probablement l’éviter pour conserver les institutions de leur voisin qui rendaient le pays ingouvernable et faible[32].
La France avait déjà deux représentants à Varsovie: l’ambassadeur est le marquis de Paulmy d’Argenson, fils de l’ancien ministre des affaires étrangères, et Pierre-Michel Hennin est « résident ». Hennin était affilié au Secret. Les consignes qu’il reçoit vont jusqu’à prescrire ce qu’il doit dire au ministre par la voie officielle: « Vous devez continuer à vous occuper des différents objets qui vous ont été prescrits par la voie secrète, observer et mander ce qui se passe, intéresser le ministre du roi pour les affaires de la Pologne, sans les lui présenter sous un point de vue trop dangereux, ni trop rassurant. »[33]
Peu avant la mort d’Auguste III, Stanislas Poniatowski était venu voir Hennin pour tenter d’obtenir le soutien de la France. Influencé par les Lumières, il se serait sans doute bien vu en monarque éclairé. Il souhaitait faire part des ambitions réformatrices qu’il avait pour son pays. Sans doute cherchait-il à s’émanciper de la Russie, il pressentait qu’il ne serait qu’une marionnette aux mains de Catherine II, ce qui fut le cas. Hennin prévint d’abord le roi, via la correspondance secrète, puis il prévint également le ministre. Il n’eut pas pour instruction de prendre parti: il dut tâcher de « susciter avec adresse parti contre parti, pour en empêcher un de prendre la prépondérance, et afin que sa Majesté… puisse se déclarer pour celui qui conviendra le plus à ses intérêts. »[34]
Aux deux représentants déjà présent à Varsovie, le duc de Praslin en rajoute un troisième: le général Jean-Antoine Monet, qui a longtemps vécu en Pologne où il était proche du parti des Czartoryski. Monet est nommé Consul général en Pologne, a priori un poste non strictement politique. Il doit officiellement aller à Dandzig, pour s’occuper des affaires commerciales à l’embouchure de la Vistule. Ce n’est qu’un prétexte, il a pour mission d’aller à Varsovie pour s’aboucher au nom du roi avec ses connaissances. Tercier, chef du Secret, avertit le roi: « Il est certain que si on ne parle pas de l’affaire secrète au général Monet, Sa majesté aura en Pologne trois agents qui prendront tous les trois une route différente et par conséquent ne se rencontreront pas. »[35]
Le roi comprend: « Le sieur Tercier pourra s’ouvrir au général Monet sur mes vues secrètes regardant la Pologne, sans lui communiquer ce qui s’est passé anciennement, et lui indiquant le sieur Henin, à qui seul j’ay donné la correspondance de mon secret. Louis.
A Versailles, ce 19 novembre 1763. »[36]
Une fois Monet initié au Secret, Tercier lui fait répéter les consignes que lui a donné le ministre Choiseul-Praslin: le général doit « aller trouver les Czartoryski, leur dire que dans la circonstance où S.M. se trouve, elle ne peut se dispenser de faire en apparence, des démarches pour l’Electeur de Saxe, mais qu’ils ne doivent en concevoir aucune inquiétude puisque ce n’est pas ce prince que S.M. désire voir sur le trône de Pologne, mais un piaste [un noble polonais], et que, si le choix tombe sur un prince de leur maison, on en sera charmé ici et qu’il sera d’abord reconnu, pourvu qu’il conserve le royaume de Pologne dans toutes ses libertés et dans l’intégralité de ses possessions… En un mot, sa véritable mission est de persuader au futur Roi, quel qu’il puisse être, que nous avons contribué à son élection et qu’il devra nous en marquer sa reconnaissance. »[37]
On peut le constater, la diplomatie française était complexe, voire confuse.
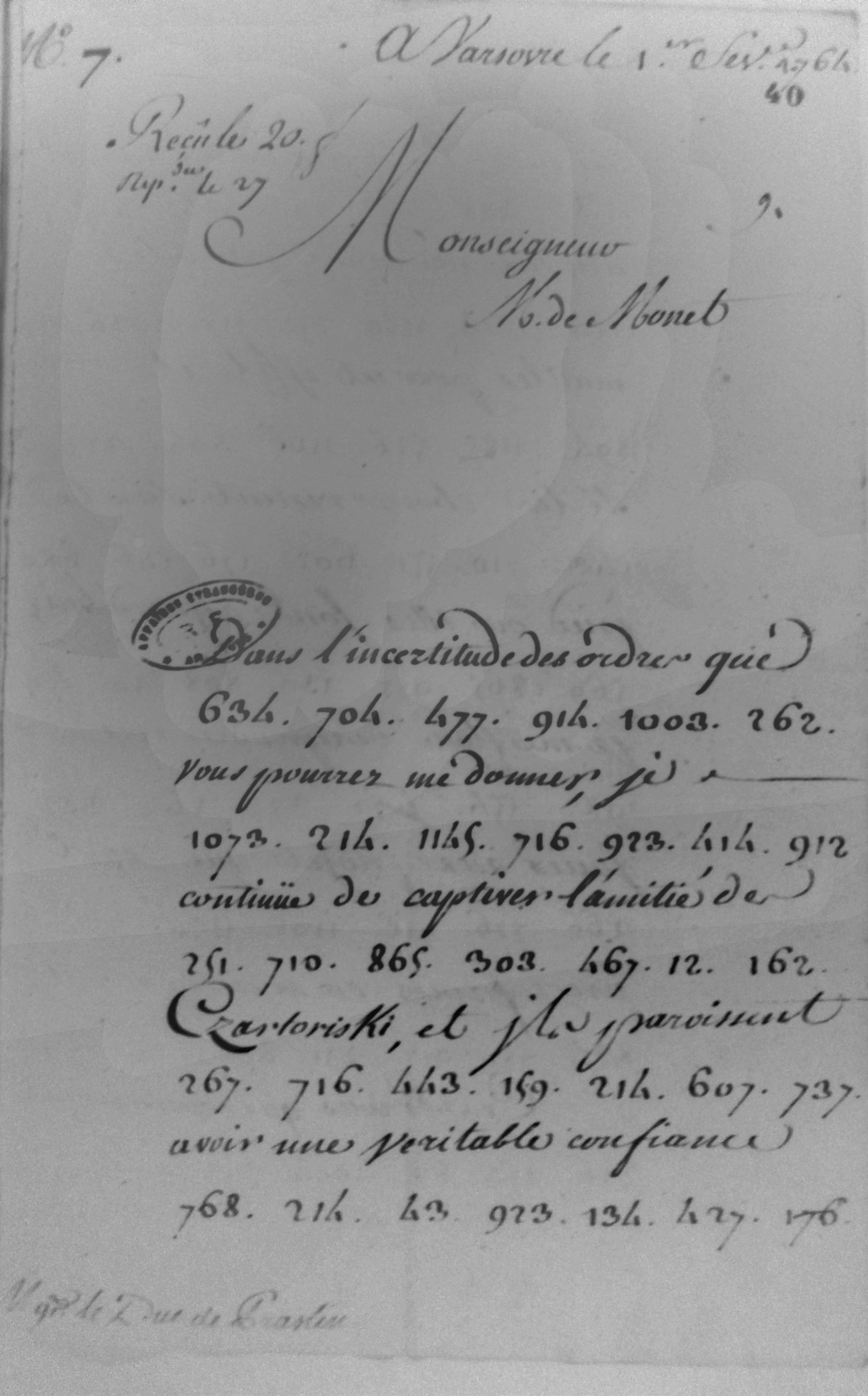
Lettre du général Monet, envoyé en Pologne en 1764
C’est probablement avec le général Monet que Jacques Goffinet est parti en Pologne, car les dates et la durée du séjour (9 mois) correspondent. On sait qu’il a logé dans la maison du résident Henin à Varsovie[38]. On a dit qu’il était rare qu’un commis des affaires étrangères accompagne une mission à l’étranger. Or, il n’est pas improbable que les Choiseul aient eu connaissance de l’existence du Secret. Dès 1759, le renvoi de Tercier de son poste de premier commis l’avait fait soupçonner. Les Choiseul auraient-ils voulu espionner le Secret ? On ne peut que conjecturer sur l’envoi de Jacques Goffinet -commis des affaires étrangères et créature des Choiseul- auprès de Henin et Monet, tous deux initiés à la double diplomatie.
Les alliés de la France ne se montrèrent pas décidés à intervenir. Le système méridional comme on l’appelait à l’époque (l’alliance France-Autriche-Espagne) n’enverra ni troupe ni argent. Louis XV écrit à Tercier le 22 mars 1764: « L’Espagne se refuse à tout secours, Vienne aussi; par conséquent, nous ne pouvons rien donner au prince de Saxe que, comme eux, des recommandations. »[39]
C’est donc un polonais qui doit être choisi, et le candidat du Secret est le grand-général Branicki. Mais à l’approche de la convocation de la diète, la Prusse et la Russie s’unissent pour soutenir Stanislas Poniatowski. L’armée russe s’installe sur le territoire polonais. La présence des armées, tant russe que polonaise, lors des assemblées, instaure un climat de guerre civile dans le pays. En mai 1764, les membres du parti des patriotes autour de Branicki refusent d’ouvrir la séance de la diète et quittent Varsovie. Le ministère décide alors de retirer l’ambassadeur d’Argenson de cette nasse: « Sa majesté ne voyant plus dans la République de Pologne qu’un corps déchiré et insubstant, et prévoyant d’ailleurs que son ambassadeur pourrait être exposé à quelques insultes au milieu de la soldatesque étrangère a jugé plus convenable de le retirer d’un séjour où les voies de la violence vont sans doute être substituées aux voies de la négociation. »
Mais Monet et Hennin doivent rester: « vous resterez, Monsieur, puisque le caractère dont vous êtes revêtu est moins délicat à ménager que celui d’un ambassadeur et n’expose pas aussi essentiellement la dignité du Souverain. »[40]
L’insulte à l’ambassadeur du roi avait été anticipée. Ce n’est pas d’un soudard russe qu’elle viendra, mais du primat de Pologne lui-même. Avant l’élection, l’archevêque de Gniezno était l’interroi (titre inspiré de la Rome antique; sous la République romaine l’interroi était nommé après la mort des consuls).
Le 7 juin 1764, le marquis d’Argenson vient lui annoncer qu’il rentrait en France, car il y avait une scission en Pologne et qu’il ne pouvait rester dans une partie de celle-ci. Le primat lui aurait répondu : « puisque vous ne reconnaissez pas la République, allez la chercher où il vous plaira », et « Si nous ne sommes pas la République, allez la chercher: nous ne reconnaissons plus d’ambassadeur. Je salue M. le marquis. » Celui-ci aurait répliqué à l’interroi : « Salut à l’archevêque de Gniezno. »
La France est officiellement offensée. Le 16 juillet 1764, elle retire tout son personnel diplomatique (Hennin et Monet avec Goffinet). Elle est suivie par ses alliés autrichiens et espagnols. Stanislas Poniatowski est élu comme prévu le 7 septembre 1764, mais la France ne le reconnaîtra comme roi qu’en 1766. L’influence de la France en Pologne a beaucoup déclinée.
Malgré cet échec, le Secret continue, et avec lui l’espionnage par le roi de ses propres ministres. Après le retour de Monet, Louis XV écrit au duc de Broglie, chef du Secret, le 29 août 1764 : « La situation actuelle de la Pologne me faisant désirer d’être instruit précisément de tout ce qui s’y est passé depuis l’interrègne, vous direz de ma part au général Monet, qu’il vous communique les instructions et les lettres qu’il a reçues du duc de Praslin, ainsi que ses réponses, de même que ses lettres au comte Poniatowski et les réponses qu’il en reçoit, pour que du tout vous en composiez un extrait exact que vous m’envoierez. »[41]
Le Secret continuera jusqu’à la mort de Louis XV. Même s’il a échoué dans ses principaux objectifs (couronne polonaise ou débarquement en Angleterre), beaucoup des hommes qui le constituaient resteront en place sous Louis XVI: Vergennes, ministre des affaires étrangères et principal ministre, sera avec Beaumarchais un acteur important de la guerre d’indépendance américaine. Hennin sera premier commis, et Dumouriez sera même ministre sous la République. Le membre du Secret le plus célèbre, le fameux Chevalier d’Éon, après avoir joué un rôle important lors des négociations du traité de Paris en interceptant des documents confidentiels à Londres, finira sa vie en Angleterre en se faisant passer pour une femme.
FAMILLE
Le 15 janvier 1767, Jacques Goffinet épouse Marie Thérèse Joubain de Doisu dans l’église Saint-Louis de Versailles. Elle est la fille de François Joubain de Doisu, avocat et jurisconsulte des affaires étrangères dans le même bureau que Jacques Goffinet. Le contrat signale d’ailleurs que le mariage est « de l’agrément de Monseigneur le duc de Choiseul, ministre de la guerre et Monseigneur le duc de Praslin, ministre des affaires étrangères »[42].
La famille Joubain est une famille de marchands installés à Versailles dès la fin du XVIIe siècle. François Joubain, le beau-père de Jacques Goffinet, mena avec succès une carrière de juriste et d’avocat. Son nom est fréquemment cité dans les actes notariés et paroissiaux de Versailles. Avait-il une spécialité en droit international ? En tout cas le ministère des affaires étrangères fit appel à lui. À plusieurs reprises, il écrivit des avis et des mémoires sous les ministères Rouillé (1754 à 1757) et Bernis (1757 à 1758). Dès son arrivée, Choiseul l’embauche pour de bon comme « jurisconsulte et homme de lettres » du ministère[43]. Il rompt « tous ses liens suivant les ordres de monseigneur pour s’attacher à cet unique objet ». Il obtient un bureau particulier à Versailles, mais aussi à Compiègne et à Fontainebleau (lieux où se déplace parfois la cour). D’après son dossier, sa mission fut de « répondre à des questions de droit public et des gens, de droit civil, criminel et bénéficial, à expliquer les formes judiciaires en vigueur au Conseil ou dans les autres tribunaux du royaume, à donner des interprétations de traités, des traductions en langue française et latine et même pour remplir les vides, à faire des extraits de plus de quarante années de diverses correspondances. »
L’élargissement du royaume à l’est (Alsace et Lorraine) posait des problèmes juridiques complexes dans le rapport avec le Saint-Empire, notamment avec les princes possessionnés (princes allemands qui avaient conservé des fiefs enclavés dans le royaume de France)[44], mais il y avait un autre jurisconsulte qui semblait spécialisé sur ces questions. Il semble plutôt que le recrutement de Joubain soit lié à la guerre. Sa place fut intégrée au premier département, le même que celui de Goffinet. Il fut réformé en même temps que lui, en janvier 1767 (Choiseul « profitant des circonstances de la paix ») et ne revint pas au ministère.
Il se faisait appeler Joubain de Doisu, car il avait hérité de son épouse d’une seigneurie à Doisu, qui est aujourd’hui un quartier de la commune de Chaville, entre Versailles et Paris. Fief très modeste[45], il est décrit ainsi dans un document de 1741:
« Une maison seigneuriale, bâtiments, cour, jardin, prés, avenue, etc..; le tout contenant vingt arpents neuf perches
Cinquante-deux perches de près
28 sols 6 deniers de cens à prendre sur deux arpents trente-sept perches et demie de terre en deux pièces
16 livres de rente foncière à prendre sur soixante-dix-neuf perches et demis d’héritage en deux pièces »
Vingt arpents ne font que sept hectares et les sommes indiquées pour le cens sont insignifiantes. Rappelons que 12 derniers font un sou, et 20 sous font une livre, salaire journalier moyen d’un travailleur non qualifié. Le cens, impôt local dû au seigneur, pouvait donc être d’un tel montant à la fin de l’ancien régime. Il s’agissait d’un droit dit réel et non personnel, c’est à dire attaché à un bien et non à une personne (les impôts tels que la corvée ou la taille ne pesaient que sur les roturiers).[46]
Cette seigneurie de Doisu fut transmise sur deux générations à des gendres qui purent ajouter ce nom à leur patronyme. Elle provenait de Magdeleine Demarins (ou Demarius?), dame de Doisu, belle-mère de François Joubain. Elle fut transmise après la mort de François Joubain à son fils Pierre-François, puis à la mort de celui-ci sans descendance en 1785, à son gendre Philippe Coqueret (beau-frère de Jacques Goffinet) qui se fit alors appeler Coqueret du Doisu.
François Joubain eut trois enfants. Son fils Pierre-François fut avocat au Parlement comme son père, mais n’eut pas le même succès. Décrit comme étant de santé fragile, il bénéficia de l’entregent de son père et de son beau-frère pour obtenir du ministre Vergennes qu’il le recommande pour un poste à la Ferme Générale (plus exactement à la « formule », la vente des timbres fiscaux et papiers à entête). Le billet de Vergennes ne mentionne d’ailleurs que le nom de « sr de Doizu », ce qui causera un imbroglio car les services de la Ferme Générale ne reconnaîtront pas Pierre François Joubain sous ce seul nom, et cela ralentira l’avancement.
Bien que renvoyé, Joubain continua à recevoir une pension. Après sa mort en 1783, ses trois enfants, dont l’épouse de Jacques Goffinet, toucheront également une pension de 600 livres chacun[47], « en considération des services du feu sieur Joubain de Doisu, père de ladite dame, en qualité de jurisconsulte pendant huit années dans les bureaux du département politique ».
L’aînée des filles, Sophie Thérèse Joubain, épousa en 1769 Henry Philippe Bon Coqueret. Coqueret était peintre du cabinet du roi. Sa fonction principale était de réaliser des copies des portraits du roi et de la famille royale. Les peintres du cabinet détenaient en effet l’exclusivité de la reproduction des originaux conservés à la surintendance des Bâtiments du roi.
La possession d’un portrait du roi était un véritable enjeu, que ce soit pour les particuliers ou pour les corps constitués du royaume. Il en était de même pour un portrait d’un membre de la famille royale, grand privilège et marque de la faveur du prince[48]. Le Cabinet des tableaux du roi se situait dans l’hôtel de la Surintendance, juste à côté des hôtels des affaires étrangères et de la Marine dont on a parlé. A la fin du règne de Louis XV, quatre peintres y étaient employés, il y en eut jusqu’à sept sous Louis XVI. Ils avaient peu de temps pour leurs propres créations, mais réalisaient de temps à autre des originaux destinés aux appartements royaux. Coqueret fut officier municipal de la ville de Versailles sous la Révolution[49]. Il fut d’abord renvoyé puis rappelé par le député en mission Charles Delacroix (père du peintre), le même qui une fois devenu ministre des affaires étrangères renverra Jacques Goffinet en 1795.
Jacques Goffinet épouse donc la benjamine de son collègue. La mère est décédée moins de deux ans auparavant; François Joubain vivait avec ses trois enfants et quelques domestiques. Goffinet épouse la benjamine et non l’ainée qui était également célibataire, signe que le mariage n’était peut-être pas totalement arrangé. Il épouse quelqu’un de sa condition, mais qui ne lui apporte aucun office et aucune charge. En effet, il était courant dans les corporations de métier ou les offices royaux que le gendre succède au beau-père qui n’avait pas de fils. Mais la place de commis ne s’achète pas et ne dépend que du talent et de la faveur des puissants. D’ailleurs les mariages au sein du ministère sont assez rares.[50]
Deux de ses collègues sont témoins du mariage. Michel Gouget était à Vienne avec lui avant d’être recruté au ministère.
L’autre témoin est aussi un collègue commis : Marc-Antoine Rochon de Chabannes. C’est un dramaturge qui connaît un certain succès à l’époque. Oublié aujourd’hui, il a cependant été publié dans la bibliothèque de la Pléiade[51]. Sa pièce la plus connue est Heureusement. Dans cette courte comédie, un mari délaisse sa femme qu’il croit ingénue et la laisse se faire courtiser par son jeune cousin Lindor, un adolescent libertin, avec l’aide de la servante délurée. Beaumarchais s’inspirera de ce personnage de Lindor pour créer Chérubin, le jeune page amoureux de sa marraine la comtesse dans Le mariage de Figaro. Le fait pour un homme de lettres de travailler dans la diplomatie est courant, Voltaire et Rousseau l’ont fait dans leur jeunesse, puis Paul Claudel, et jusqu’à Jean-Christophe Rufin, ambassadeur au Sénégal.
Rochon est également l’auteur de pamphlets politiques. En 1756, l’abbé Coyer publie La Noblesse commerçante, brochure qui provoque de nombreux débats sur l’interdiction faite à la noblesse de commercer sous peine de déroger. Elle se termine ainsi: « Le remède est sous la main. C’est celui qui s’exprime dans le titre même de l’opuscule. Autorisez la noblesse à commercer, elle retrouvera, rapidement sa fortune et son prestige, et pourra ensuite, mais ensuite seulement, recommencer à s’acquitter de ces fonctions honorifiques qu’une longue tradition la rend plus apte que tous autres à remplir. Conclusion : Il faut abolir cette loi singulière et gothique de dérogeance »[52]
De nombreuses brochures sont éditées en réaction, le débat est animé. Trop même, au goût du critique littéraire Frédéric Melchior Grimm, qui écrira, lassé: « Il faut espérer qu’on nous laissera en paix avec cette noblesse commerçante et non-commerçante. »[53] Le gouvernement prépara un projet de réforme qui n’aboutira pas. Le chevalier d’Arcq, petit-fils bâtard de Louis XIV, réplique notamment en publiant La Noblesse militaire. Cette brochure défend l’idée que la noblesse ne devrait se consacrer qu’à la carrière militaire, et dérogerait même en refusant de servir. Une concordance serait établie entre titre nobiliaire et mérite militaire. Rochon réagit à la façon des ironistes de son époque. Après La Noblesse commerçante et La Noblesse militaire, paraît La Noblesse oisive[54]. En voici quelques extraits:
« Les emplois dans le Militaire se vendent aux Roturiers, au lieu d’être donnés aux Gentilhommes; on n’en bat pas moins l’ennemi. La Noblesse rougit d’entrer dans le commerce, et traîne à la campagne une vie misérable; cela rabat de sa fierté… Laissons donc les choses dans l’état où elles sont; je vous demande grâce surtout pour nos Petits maîtres; quel mal vous ont-ils fait, pour vouloir en faire des hommes ? »
« Que vous propose-t-on, à vous qui êtes accoutumés au faste et aux plaisirs de la ville ?…
Regardez la considération dans laquelle vous vivez, la dépense que vous faites au delà de vos revenus, effets naturels de votre faste; il vous annonce; il en impose; vous êtes riches de deux cent mille livres de rente, avec un peu d’impudence vous trouverez le secret de dépenser un million de revenu; voilà votre bien augmenté de huit cent mille livres. Cent personnes commerceront pour vous, tenez vous tranquille. »
« L’oisiveté est la source de l’émulation, elle anime les talents, entretient les arts, adoucit les mœurs, augmente la population et fait naître le luxe qui soutient la capitale et décharge la Province. »
« Il ne convient donc pas que le grand embrasse [le commerce]; c’est lui qui dépense, il ne faut pas que ce soit lui qui acquiers. Il est également inutile et dangereux de l’engager à se mettre dans le service, on peut battre l’ennemi sans son bras; la Capitale ne saurait se soutenir sans sa dissipation. »
Voilà ce que pouvaient écrire les commis du très autoritaire duc de Choiseul !
Les autres actes paroissiaux permettent d’avoir un aperçu des fréquentations de la famille Joubain/Goffinet:
Un fils -François Michel Jacques Goffinet- naît le 10 octobre 1767[55], mais ne vivra qu’un an. Le parrain de l’enfant est son grand-père maternel François Joubain. La marraine est Michelle-Marie Delalande, épouse de M. Claude Coulon, docteur en médecine. Cette Michelle-Marie Delalande n’est autre que la fille du compositeur Michel-Richard Delalande (parfois orthographié de la Lande), surintendant de la musique du roi sous Louis XIV. Delalande est un des compositeurs les plus joués au XVIIIe siècle. Sa fille est une amie de la famille: François Joubain était témoin du mariage de Michelle Marie Delalande et de Claude Coulon en 1750.
Il était d’usage à l’époque chez les familles bourgeoises de confier les nourrissons à des nourrices à la campagne[56]. Les enfants de Jacques Goffinet étaient peut être « en nourrice » chez leur grand-père au Doisu. Cela expliquerait que le fils décède en 1768 dans la maison de son grand père. Il est également possible que Jacques Goffinet ait quitté Versailles en 1768, année de sa suspension. Le témoin du décès est un tailleur d’habit polonais vivant à Versailles, Martin Vytlacil[57]. Sa présence n’a peut-être aucun lien avec la mission de Goffinet en Pologne, il a pu faire partie de la communauté polonaise protégée par la reine Marie Leszczyńska.
Le parrain de Thérèse Sophie Goffinet qui naît le 10 mai 1769 est Albert François Floncel, avocat au Parlement et censeur royal. Il avait travaillé quelques années au ministère des affaires étrangères. Avocat comme les Joubain, il travaillait également au sein du Bureau de la Librairie, chargée de la censure. Il n’était pas membre de la section « Jurisprudence », mais de la section « Belles lettres »[58]. Le bureau comptait plus de cent-soixante-dix censeurs: il avait la taille d’un véritable ministère[59]. Il était fréquent que les censeurs cumulent cette fonction avec une autre: Tercier, le premier commis des affaires étrangères et chef du Secret dont on a déjà parlé, fut disgracié à cause d’une erreur dans sa fonction de censeur, avoir donné l’imprimatur au philosophe antichrétien Helvetius. Voici la notice que consacre à Floncel le dictionnaire biographique La France littéraire en 1769:
« FLONCEL, (Albert-François) né à Luxembourg en 1697, Avocat en Parlement, censeur royal, membre de l’académie des Arcades de Rome, etc.. en 1731 Secrétaire d’Etat de la principauté de Monaco. En 1739, premier secrétaire des affaires étrangères sous MM Amelot et d’Argenson… Le goût décidé de M Floncel pour la Langue et pour la Littérature italienne, lui a fait former depuis quarante cinq ans une Bibliothèque singulière et précieuse, unique en France, peut être même en Europe. Elle est composée d’environ onze mille volumes en cette même langue; il l‘augmente tous les jours; elle est connue par tous les journaux et écrits périodiques; il se fait un plaisir de l’ouvrir aux curieux de cette espèce de littérature qui ont besoin de la consulter. »[60]
La bibliothèque de François Joubain paraît pauvre au regard de celle de son ami Floncel, elle est néanmoins bien constituée, l’inventaire après son décès montre une bibliothèque assez conséquente de divers ouvrages de « jurisprudence, histoire, belles lettres et théâtre »[61]. Son fils puis sa fille en hériteront. Dans l’inventaire après décès de sa fille Marie Thérèse en 1790, on trouve notamment une « Encyclopédie nouvelle édition in 4 en soixante quinze volumes brochés cartonnés compris les planches, prisée 400 livres », il s’agit bien sûr de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert.
La dernière fille, Marie Félicité Goffinet qui naît en 1771, a une marraine qui selon l’usage lui donne ses prénoms: Marie Félicité Germain. Elle est l’épouse de Guillaume Baudet, entrepreneur des pavés du roy, plus tard qualifié également d’entrepreneur des « bâtiments et domaine du roy » ou « entrepreneur du pavé des hôpitaux de Paris ». Cette marraine épousera en seconde noces Jean Barre, architecte. Le milieu du bâtiment paraît avoir été fréquenté par la famille.
Pour être complet, voici une liste de mariages dont François Joubain a été le témoin à Versailles et à Chaville[62].
07/07/1750 DUCAYET de GIRONVILLE Louis avocat (cousin du médecin Colomb)
26/11/1754 FRANCISQUE MILET Joseph, peintre du roi et MANICLERC Madeleine (ami de l’épouse)
23/04/1770 MANAUT David serrurier à Versailles
08/05/1770 MARQUIER de CRUZ Jean Baptiste Daniel capitaine de cavalerie et VIOT Geneviève Jeanne fille de Louis, commis de la guerre
20/04/1773 GUILLOIS François commis des affaires étrangères
28/04/1774 MARCHAND Pierre François musicien du Régiment des Suisses et MOREAU Marie Anne marchande de toiles
15/02/1776 LOUIN Jean marchand de toiles
16/07/1777 DUFOSSAY Jean Etienne, témoin de l’épouse MARIN Anne, fille de Pierre Nicolas officier porte carreau de la reine[63]
28/09/1779 MOUFFLE Claude blanchisseur de Chaville
Cette participation importante, surtout dans les années 1770, s’explique peut-être par sa profession d’avocat (on ne trouve pas de mention des autres membres de la famille dans les registres paroissiaux).
Avocats, littérateurs, artistes, entrepreneurs, artisans: voilà les fréquentations de la famille.
Versailles
Plus de deux siècles plus tard, la vie quotidienne à Versailles peut paraître à nos yeux un curieux mélange de faste et de sordide. Les bals masqués et les concerts étaient réguliers. Les fêtes données pour le mariage du dauphin (futur Louis XVI) en 1770, et de ceux de ses frères (1771 et 1773) furent grandioses: feux d’artifice, barques à lanternes sur les canaux, banquets extraordinaires etc…
Mais les voyages de la cour à Marly étaient parfois déterminés non par un soudain caprice royal, mais par la nécessité de vider les fosses d’aisance[64]. La puanteur était épouvantable. Il y avait des décès parmi les ouvriers vidangeurs que l’on saoulait à l’eau de vie. Certaines fosses étaient creusées juste sous le pavage et débordaient parfois dans les cours. Il y eut cependant des progrès dans les années précédant la Révolution: d’abord fut mis en œuvre un système de pompes pour vider les fosses, puis une ébauche de fosse septique moderne dans la rue de la Surintendance où se trouve l’hôtel des affaires étrangères (réservoir séparé et absorption par le sol)[65].
Versailles est à la veille de la Révolution une ville de 50.000 habitants, dont l’essentiel de l’activité est évidemment tournée vers le château. Comme l’ont souvent les capitales, Versailles a un statut particulier. Le gouverneur du château était également celui de la ville et ne dépendait que du roi. Versailles n’avait donc aucun corps de ville contrairement aux autres grandes villes du royaume. Cette absence fut comblée par l’ordonnance royale du 18 novembre 1787, et les premières élections municipales furent organisées.
Versailles n’est plus une ville très à la mode. Beaucoup d’offices royaux fonctionnent par quart, c’est à dire qu’ils doivent remplir leur office à la cour un quart de l’année. Le reste de l’année, beaucoup d’officiers logent à Paris et ont une seconde profession. La pression foncière est cependant forte: la maison où loge le couple Goffinet et qui vient de l’héritage Joubain, a une certaine valeur. Versailles compte un certain nombre d’hôtels, et beaucoup de particuliers louent des logements qui sont recherchés lors d’évènements particuliers. Ce fut notamment le cas lors de l’assemblée des notables en 1787. Le nombre de ces notables n’était pas si élevé, mais ils étaient accompagnés.
Puis en 1789, lors des états généraux, il fallut loger les 1154 députés des trois ordres et ceux qui les accompagnaient. Le roi ordonna à la nouvelle municipalité de Versailles de préparer 1200 logements.
Selon un témoignage de l’époque les députés du tiers état furent plutôt bien accueillis par la population de la ville:
« Mais autant l’accueil fait à ces derniers par la cour fut insultant, autant celui qu’ils trouvèrent dans la ville fut bienveillant et affectueux. Admis avec empressement dans les maisons des citoyens où plusieurs s’étaient fait recevoir en pension, ils y exhalaient en liberté leur ressentiment et le firent partager. Ainsi, malgré les injonctions de la cour, malgré la dépendance où presque toute la population se trouvait envers elle, cette population se prononça hautement en faveur des opinions nouvelles, et s’y attacha tellement qu’elle finit par devenir tout à fait hostile. La suite a prouvé que ces dispositions n’étaient pas à dédaigner. »[66]
Le voisin immédiat de Goffinet en 1789 est Charles Antoine Chasset, député du Tiers-Etat de la sénéchaussée du Beaujolais, qui sera président de l’Assemblée Constituante en 1790. Ils font connaissance. Cela aura une grande importance plus tard dans la carrière de Jacques Goffinet.
Révolution
Lors des états généraux de 1789 il fut établi un système de représentations à plusieurs niveaux, tant pour les élections que pour la rédaction de cahiers de doléance. Chaque assemblée désigna des représentants pour l’assemblée de niveau supérieur: Corporation ou paroisse pour ceux qui n’en sont pas membre, Ville de Versailles, Bailliage de Versailles, Prévôté et Vicomté hors les murs de Paris, et enfin Etats généraux pour le Tiers Etat. Versailles fut donc particulièrement mal représentée au regard de sa population plus importante que celle des autres villes de Paris-hors-les-murs. Ce sera la première récrimination du cahier de doléances de la ville. Les deux paroisses de Versailles nommèrent des représentants qui siégèrent à l’assemblée de la ville avec les représentants des vingt-cinq corporations de métier.
Le 12 avril 1789, un huissier lit la lettre du roi pour la convocation des états généraux à un carrefour accompagné de deux tambours, comme c’était l’usage. L’assemblée de la paroisse St Louis se réunit le 14 avril à 11h30 du matin; 114 hommes sont présents, dont peut être Jacques Goffinet. Versailles n’est pas une ville comme les autres: parmi les quatre élus de la paroisse on compte un commis au bureau de la guerre, un commis au bureau de la marine, un commissaire et un brigadier des armées. Tous sont donc employés à la cour.
La présence des représentants des corporations (médecins, merciers, cordonniers, boulangers etc.) rend l’assemblée de la ville plus commune à celle des autres. Les commis des ministères sont suspects pour certains révolutionnaires avancés. Un représentant des merciers-drapiers dépose une motion visant à les exclure, motion repoussée par la municipalité dirigeant l’assemblée.
« Au moment d’ouvrir la séance, le sieur Lecointre a fait lecture d’une motion tendante (sic) à exclure des élections les premiers commis, chefs de bureaux et autres personnes attachées au ministère, laquelle motion il a mise sur le bureau, en requérant acte de sa demande, et qu’il en fût délibéré à l’instant.
La motion mise en délibération entre nous, nommé par le roi juge en cette partie, nous avons arrêté unanimement que, conformément à l’art. 25 du règlement, il ne peut être prononcé d’exclusion dans les élections contre aucun citoyen né Français ou naturalisé, âgé de 25 ans, domicilié et compris au rôle des impositions ; En conséquence, nous avons débouté ledit sieur Lecointre de sa demande, et ordonné qu’il sera passé outre, et procédé à l’ouverture de la séance, nonobstant opposition ou appellations quelconques, sauf au sieur Jean Lecointre à se pourvoir par-devant S. M. par voie de représentation et par simple mémoire. »[67]
Le cahier de doléance de Versailles est en grande partie un projet de constitution et une apologie des droits de l’homme, rédigée par Louis de Boislandry, un négociant de Versailles qui, malgré le nombre de strates d’élection, sera élu aux états généraux.
Les demandes plus prosaïques concernent la construction de fontaines dans la ville, l’établissement de marchés, la construction d’un canal Loire-Seine passant par Versailles (à l’époque la seule grande ville de France sans mer ou rivière à proximité), la libre traversée de Paris des marchandises destinées à Versailles et la vente des maisons de la ville appartenant à sa majesté qui ne lui sont point utiles.
Cette dernière demande se réalisera largement, mais la baisse considérable du nombre d’habitants due au déménagement du roi à Paris puis à l’instauration de la République causera une baisse des valeurs foncières que n’imaginaient sûrement pas les propriétaires versaillais.
Le 4 mai, les états généraux sont ouverts par une longue procession traversant la ville, allant de l’église Notre Dame à celle de St Louis. Derrière le clergé de Versailles, défilent les députés du Tiers, puis ceux de la noblesse, ceux du clergé et enfin la famille royale au complet. Il y a déjà une querelle à propos des places de chacun dans l’église. Dans les jours qui suivent l’assemblée se réunit dans la salle de l’hôtel des menus plaisirs jusqu’à sa proclamation en assemblée nationale le 17 juin. Puis, quand le roi la fait fermer sous prétexte de travaux pour préparer une déclaration qu’il doit faire, l’assemblée se réunit au jeu de paume le 20 juin (elle jure de ne pas se séparer avant d’avoir rédigé une constitution). Le 21 juin elle se réunit dans l’église St Louis, lorsque des membres du clergé se joignent à l’assemblée.
Tous ces évènements se déroulent dans un espace très restreint, devant le château, dans un espace praticable en quelques minutes à pied, près du domicile de Goffinet.
Le ministère des affaires étrangères continue son activité, mais le ministre se mêle de politique intérieure. Montmorin a succédé à Vergennes en 1787. Il est devenu proche de Necker, « directeur général des finances » depuis 1788, et est comme lui favorable à la réunion des états généraux, au doublement du Tiers, au vote par tête. Montmorin est un des rares membres du Conseil à souhaiter une constitution à l’anglaise. Les clans politiques sont néanmoins instables: il prend parti contre Necker en avril 1789 et l’accuse d’affaiblir la monarchie.
Necker refuse d’assister à la séance royale du 23 juin 1789 dans laquelle Louis XVI fixe les limites des concessions qu’il est prêt à accorder aux députés du tiers état, et il est renvoyé le 11 juillet. Montmorin est renvoyé en même temps. Un nouveau ministre est nommé pour quelques jours : La Vauguyon, auparavant ambassadeur en Espagne. Il prend ses fonctions le 13 juillet, et démissionne le 16 après les émeutes parisiennes, et tente même de fuir à l’étranger. Montmorin est rappelé le 25 juillet, à la suite de Necker.
Un biographe de sa fille -la fameuse Pauline de Montmorin, comtesse de Beaumont, qui vint mourir à Rome près de Chateaubriand- décrit joliment l’action ministérielle de Montmorin : « On peut diviser en trois périodes son ministère depuis la convocation des états-généraux : la première, où, d’accord complètement avec Necker, désirant comme lui une constitution, il s’approcha du système politique de l’Angleterre, et conserva l’espoir d’obtenir par les voies de la conciliation ce changement de la noblesse et du roi ; la seconde période dans laquelle, voyant la révolution varier d’objet, poursuivre l’égalité plus que la liberté et rêver l’établissement d’une sorte de démocratie royale, il tenta avec Mirabeau d’arrêter les exagérations et de créer le parti modéré au milieu des tourmentes populaires ; la troisième période enfin, où, tous les moyens de se défendre manquant successivement à la royauté, Montmorin concentra tous ses inutiles efforts à sauver la personne même de Louis XVI. Ce fut le temps où il écrivait au comte de La Marck ce billet désespéré : j’ai pleuré ce matin comme un imbécile chez le roi ; il en a fait autant. Tout cela ne remédie à rien. »[68]
Après les émeutes, le roi est allé à Paris le 17 juillet pour arborer la cocarde tricolore à la fenêtre de l’hôtel de ville. Le respect envers la noblesse et envers le roi s’atténue. Le baron de Besenval raconte que le 19 juillet, il était rentré chez le roi pour lui faire signer un ordre : « Dans le moment où je lui présentait cet ordre, un valet de pied se place familièrement entre ce prince et moi pour voir ce qu’il écrivait. Le roi se retourna, aperçut l’insolent et courut se saisir des pincettes. Je l’empêchai de suivre ce mouvement d’une fureur très naturelle. Il me serra la main pour me remercier et je remarquai des larmes dans ses yeux. »[69]
Les commis des affaires étrangères deviennent-ils aussi insolents que ce valet ? C’est peu probable, mais l’incident est tout de même révélateur. Autre signe: à partir d’août des députés ne mettent plus leurs habits distinctifs. Certains remplacent leurs habits sombres par des habits colorés.
Jusqu’au 5 octobre, une foule plus ou moins importante s’ajoute au millier de députés. On peut l’imaginer exerçant une pression: lors de la séance du 20 juin, le seul opposant est sorti par une porte dérobée pour l’éviter.[70] Le maire de Versailles, qui porte ce titre depuis le 11 juillet, déclare le 20 juillet: « Il ne faut pas douter, Versailles est depuis plus de trois mois remplie de gens sans aveu; et qui nous dira si, dans le nombre, il n’y en a pas qui nous préparent quelque affliction nouvelle. Je pense donc, Messieurs, qu’il serait de notre prudence de nous concerter et d’employer les soins de la municipalité et ceux de messieurs les électeurs pour connaître, surveiller, éloigner même, s’il le faut, non seulement les mendiants, mais encore les étrangers qui abondent dans cette ville. »[71]
On constate à Versailles un afflux de mendiants, vagabonds, et même de prostituées accompagnant les troupes. La peur provoquée par cette foule contribue donc à la constitution de la garde nationale, et celle-ci contribue largement à la Révolution. Une milice bourgeoise est constituée le 28 juillet, à partir de tous les citoyens de 18 à 60 ans volontaires domiciliés à Versailles. Jacques Goffinet a alors 59 ans, il est peu probable que le vice-doyen des commis soit volontaire.
Mais une bonne partie du personnel du château s’inscrit dans cette nouvelle garde nationale de Versailles et porte fièrement leurs uniformes. D’après Mme Campan, « Tous les valets du roi de la dernière classe furent transformés en lieutenants, en capitaines. Presque tous les musiciens de la chapelle osèrent paraître un jour à la messe du roi avec un costume militaire et un soprano d’Italie y chanta un motet en uniforme de capitaine de grenadiers. Le roi en fut très offensé et fit défendre à ses serviteurs de paraître en sa présence avec un costume aussi déplacé. »[72]
La garde nationale se substitue peu à peu au régiment des gardes français. Beaucoup de ses membres désertent de leur régiment et rejoignent la garde nationale. À Versailles, le roi ne peut plus vraiment compter que sur les gardes du corps et le régiment d’élite des Cent suisses.
Versailles n’est pas strictement concernée par la Grande Peur, cette curieuse onde de panique qui se répand dans tout le pays à la fin de juillet et au début d’août 1789. Néanmoins, c‘est peu dire que les évènements parisiens suscitent l’effroi à la cour de Versailles. Le 22 juillet sous prétexte d’accaparement du blé, le contrôleur général des finances Foulon est arrêté et pendu à un réverbère devant l’hôtel de ville puis décapité. Sa tête est placée en haut d’une pique. Son gendre Bertier, intendant de Paris, est obligé d’embrasser la tête de son beau-père avant d’être décapité à son tour.
La prévôté de l’Hôtel du Roi, chargée de juger les crimes et délits commis dans les résidences royales, avait condamné un homme jugé pour parricide « à faire amende honorable devant l’église Notre-Dame, avec un écriteau portant le mot “parricide” ; puis à être conduit à la place du marché de Versailles pour y être rompu vif, mis ensuite sur la roue, puis son corps brûlé et ses cendres jetées au vent. » Le 11 août la foule arrache le condamné sur la place du marché de Versailles. La garde est bousculée et le bourreau chassé. Une femme qui s’y oppose est pendue, avant que la corde ne soit coupée.
La justice royale est complètement bafouée, à Versailles même. Le peuple s’oppose aussi à l’entrée de chasseurs venus maintenir l’ordre. Cela affectera Louis XVI qui fera allusion à ces évènements dans sa déclaration de 1791 rendue publique lors de sa fuite[73]. Il y parle bien du peuple de Versailles et non de celui de Paris: « Cependant on accoutumait de plus en plus le peuple au mépris de la royauté et des lois : celui de Versailles essayait de pendre deux houzards à la grille du château, arrachait un parricide au supplice, s’opposait à l’entrée d’un détachement de chasseurs destiné à maintenir le bon ordre, tandis qu’un énergumène faisait publiquement au Palais Royal la motion de venir enlever le Roi et son fils, de les garder à Paris, et d’enfermer la Reine dans un couvent, et que cette motion, loin d’être rejetée avec l’indignation qu’elle aurait dû exciter, était applaudie. »
En effet, à partir du mois d’août on parle de la volonté des Parisiens d’amener le roi à Paris, et a contrario d’une fuite du roi. Le 5 octobre, les femmes parisiennes marchent vers Versailles. Elles investissent l’aile sud des ministres, mais également la salle des menus plaisirs où siège l’assemblée, et les églises de Versailles. Les ecclésiastiques sont malmenés. Les témoins parlent de femmes en état d’ivresse avancé, parfois d’hommes déguisés en femme. Toute la journée, on entend des cris, des chants et des propos d’ivrognes. La foule empêche le roi de se rendre à Rambouillet en bloquant les chevaux[74]. Au petit matin du 6 octobre, le château est envahi. Deux gardes du corps sont décapités et leurs têtes sont mises au bout de piques. Le roi apparaît ensuite au balcon et promet de se rendre à Paris. Le cortège part vers 14h et avance lentement dans des rues noires de monde. Les deux têtes coupées sont ramenées à Paris.
Goffinet a pu assister à l’invasion du palais pour lequel il travaille depuis plus de vingt-cinq ans. C’est la fin de Versailles comme lieu de pouvoir. Dès l’ouverture de sa séance du jour, l’assemblée nationale se déclare inséparable du roi, et toute l’administration doit suivre. L’assemblée quitte Versailles le 15 octobre, elle se réunit quelques temps dans une salle de l’archevêché attenant à Notre-Dame puis dans la salle du manège des Tuileries à partir du 9 novembre.
Le 25 novembre, Montmorin qui lui-même logeait au château, dans l’aile nord des ministres, soumet au roi un projet de déménagement du département des affaires étrangères dans deux maisons du faubourg St Germain, rue de Bourbon (actuelle rue de Lille) et rue de l’Université. Le déménagement coûtera cher, tant pour les finances nationales que pour les employés.
Ils sont dédommagés pour un montant proportionné à leur grade: 1000 livres pour les commis principaux, 800 pour les plus anciens commis de chaque bureau (dont Jacques Goffinet), 600 pour les autres commis, 200 pour les garçons de bureau[75]. C’est assez peu pour un déménagement définitif, on est loin du temps où les employés touchaient des sommes semblables à chaque déplacement à Compiègne. C’est également moins que ce que Goffinet avait touché lors de son installation à Versailles.
Goffinet est donc contraint de suivre le ministère. Il s’installe à Paris, rue Saint Dominique. Dans les mois qui suivront, Versailles se vide d’un grand nombre de ses habitants. Depuis 26 ans qu’il est installé à Versailles, il a sûrement déjà eu l’occasion de se rendre à la capitale. Mais il s’agit maintenant d’y vivre. Goffinet devient locataire à Paris comme le sont les deux tiers des parisiens[76]. Sans doute s’y rend-il avec sa femme, quelques domestiques et ses filles qu’il va penser à marier.
La monarchie à Paris (1789-1792)
Jusqu’à la fin de la monarchie, l’assemblée va peu à peu assurer sa mainmise sur le pouvoir exécutif défaillant. Les contrôles sont poussés, on demande au ministre de fournir la justification des dépenses. À la suite de la nuit du 4 août, l’assemblée a voté la transparence financière: « Sur le compte qui sera rendu à l’Assemblée nationale de l’état des pensions, places et traitements, elle s’occupera, de concert avec le roi, de la suppression de ceux qui n’auraient pas été mérités et la réduction de ceux qui seraient excessifs… »
Les affaires étrangères ne furent pas de prime abord le principal sujet des députés. Mais bientôt la menace d’une guerre entre l’Angleterre et l’Espagne provoqua un vif débat à l’assemblée. Les Espagnols avaient saisi des navires anglais qui tentaient d’établir un comptoir illégal dans la baie de Nootka sur la côte Pacifique de l’Amérique du Nord[77]. L’Espagne réclama le soutien de la France et l’application du Pacte de famille, l’alliance France-Espagne-duché de Parme entre souverains Bourbons datant de 1761.
La question diplomatique engendre une question constitutionnelle. L’extrême gauche réclame tout le pouvoir à l’assemblée, et l’extrême droite tout le pouvoir au roi. Le 22 mai 1790, une majorité se constitue et par un décret pris à demande de Mirabeau, il est décidé que la guerre serait déclarée par l’assemblée et non plus par le roi, et que les traités négociés et signés par le roi devaient être ratifiés par l’assemblée.
Un comité diplomatique permanent est ensuite mis en place pour étudier les traités en cours et contrôler le ministère. Montmorin collabore avec l’assemblée et correspond directement avec Mirabeau. Pendant cette période, il est le moins impopulaire des ministres.
Mariage des filles
Goffinet marie ses deux filles dans ces années-là. Les mariages ont lieu à Paris, dans l’église Saint Sulpice, la nouvelle paroisse de la famille.
La cadette Marie Félicité épouse le 16 juin 1790 un commis à la maison du roi (qui devient sous la Révolution le ministère de l’intérieur) Louis Grégoire Despréaux de Saint Sauveur. Il n’est pas noble, sa famille étant simplement propriétaire d’une seigneurie en Picardie. Il bénéficie cependant de protections fortes grâce à ses oncles maternels, notamment Louis de Petigny St Romain. Louis de Petigny est secrétaire des sceaux du roi et secrétaire de la Chancellerie, premier commis sous Vergennes lorsqu’il se charge des fonctions de la maison du roi (affaires relevant des municipalités du royaume ou de la religion prétendument réformée, rattachées plus tard au ministère de l’intérieur), il fut anobli en 1768[78]. C’est cet oncle qui fit rentrer Louis Grégoire Despréaux dans les bureaux de la maison du roi en 1782. Louis Grégoire resta commis au ministère de l’intérieur, puis à celui des finances jusqu’en 1814.
L’ainée Thérèse Sophie épouse le 1er février 1791 un homme de loi de Versailles, Etienne Anne Regnault, dont on sait simplement qu’avant la révolution il gérait le patrimoine de propriétaires dont il était le procureur général. Il deviendra commissaire de police sous l’Empire.
Ces mariages auraient bien évidement pu avoir lieu avant la Révolution, Despréaux a une position sociale légèrement inférieure à celle de Goffinet, mais comme l’avait Goffinet en son temps à son beau-père Joubain.
En guise de dot, les contrats de mariage prévoient pour Despréaux le versement d’une rente de 1.000 livres par an, et pour Regnault une somme de 18.000 livres, dont 8.000 versés au moment du mariage et 10.000 payables par Goffinet quand il le souhaite, mais avec un intérêt de 5%. Ce genre de contrat de mariage n’était pas rare, il est compréhensible de la part de quelqu’un qui a un revenu confortable sans avoir de patrimoine important.
On verra que Goffinet aura des difficultés à payer ces rentes. A-t-il été imprudent ? Certes, la translation à Paris, l’affaiblissement du pouvoir du roi et celui des ministres permettaient de craindre un avenir incertain pour un commis des affaires étrangères. Néanmoins, ces mariages ont lieu avant la guerre (avril 1792), avant le départ de Montmorin (novembre 1791) et surtout avant la fuite du roi jusqu’à Varennes (20 juin 1791). Il n’était pas absurde à ce moment de penser que la monarchie constitutionnelle allait se stabiliser[79]. Goffinet travaillait pour l’Etat depuis près de quarante ans, et ne se doutait peut-être pas que dès la fin 1791, des jacobins allaient réclamer le renvoi de tout le ministère.
De toute façon, il fallait bien doter les filles. Il semble que Goffinet ne disposait pas de suffisamment de capital à donner. La maison de Versailles avait probablement perdu beaucoup de sa valeur, avec la diminution du nombre d’habitants. Il n’avait donc guère le choix à moins de différer les mariages. Il est vrai que Marie Félicité (19 ans) et Thérèse Sophie (21 ans) étaient encore jeunes. Mais a posteriori on peut penser que différer les mariages aurait été une très mauvaise solution: il aurait été difficile pour Goffinet de marier ses filles au moment où il n’avait plus d’emploi.
Le risque pesait également sur les maris. Despréaux gagnait 2400 livres en 1792. Les 1000 livres de dot contribuaient donc à 30% des revenus du ménage. En cas d’impayé, ça pouvait poser problème. D’autant que Despréaux était lui aussi employé d’un ministère.
Départ de Montmorin
Dans les mois qui suivent le ministère a vraisemblablement une activité limitée. D’une part l’assemblée législative, via son comité diplomatique, le contrôle et cherche tout ce qui permettrait de compromettre un ministre jugé trop peu révolutionnaire. D’autre part beaucoup de cours étrangères ont cessé leurs relations avec la France et prétendent que le roi n’est pas libre.
Montmorin perd un protecteur avec la mort de Mirabeau le 2 avril 1791. Il est compromis par la fuite du roi jusqu’à Varennes le 21 juin 1791. Il avait auparavant juré à l’assemblée que le roi acceptait de bonne foi la constitution. Et il a surtout signé le passeport utilisé par la famille royale lors de sa fuite. Fersen l’avait sollicité au nom de Mme de Korff, pour elle et ses domestiques. Une enquête est ouverte, des députés vont venir fouiller le ministère, relire les registres. L’assemblée va officiellement innocenter Montmorin et son administration, qui ne pouvait qu’accorder le passeport. Mme de Korff existait réellement, il s’agissait d’une usurpation d’identité.
Cependant Montmorin est attaqué par les jacobins et dans leurs journaux. Brissot, à la section de la Bibliothèque, l’attaque ainsi que les premiers commis: « Ce n’est rien faire, dit-il, de renvoyer les ministres si l’on ne renvoie en même temps les sous-ministres, les premiers commis: les Reyneval, les Hennin, vétérans de l’aristocratie et les véritables acteurs qui déclament et chantent dans les coulisses, tandis que les ministres, comédiens de parade, ne font que remuer les lèvres sur l’avant-scène. »
Il ajoute : « La plupart de ces commis, qui perdent vingt-cinq ou même cinquante mille livres de rente par la Révolution, en sont désespérés et la traversent de toutes leurs forces. »[80]
Et en effet le premier commis Gérard de Rayneval confie à l’ambassadeur des Etats Unis le 8 novembre 1791 que le comité diplomatique médite « de demander à Sa Majesté le renvoi de tout le Département des affaires étrangères jusqu’aux scribes », mais qu’il est « déterminé à se défendre, la place lui est indifférente mais il luttera pour sa réputation »[81].
On exige de tous les employés de la nation un serment, le premier de ceux que Goffinet a certainement prêté: « Je jure d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout mon pouvoir la constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi. »
Montmorin démissionne du ministère en novembre 1791, mais continuera à conseiller Louis XVI et sera même auprès de lui le 10 août 1792 lorsqu’il quittera les Tuileries pour se réfugier dans la salle de l’assemblée nationale. Le fidèle ministre sera tué dans les massacres de septembre 1792.
Personne ne veut lui succéder. Les ambassadeurs (notamment le comte de Ségur, ambassadeur en Russie) auxquels le roi s’adresse déclinent ce poste dangereux. C’est donc le ministre de l’intérieur, Claude Antoine de Valdec de Lessart, qui est nommé ministre des affaires étrangères d’abord par intérim, puis définitivement le 29 novembre 1791. Il ne change rien à l’administration, tous les commis restent en place. Lessart aura le tort d’être pacifiste, alors que les girondins qui dominent l’assemblée veulent la guerre. Brissot, qui a été élu à la législative, demande le 26 décembre 1791 qu’on déclare la guerre à tous les rois. Dans un tel contexte, on ne sait trop ce que faisaient les commis du ministère en l’absence de relations diplomatiques.
Lessart sera en tout cas mis en accusation le 10 mars 1792 lorsque la guerre est devenue certaine, pour avoir trop tardé à donner des correspondances au comité diplomatique et pour avoir demandé la paix « de manière honteuse». Un déménagement du ministère de la rue de l’Université à la rue d’Artois (renommée rue Cérutti puis Laffitte) fut prévu par un bon du roi du 2 février 1792. Preuve du manque de crédit de l’Etat, le propriétaire n’accepta de louer que si Lessart s’engageait personnellement dans le bail. Plus tard, on affirma que le bon n’avait point été donné, et l’on préleva sur la succession de Lessart les frais de ce déménagement. Lessart sera lui aussi tué lors des massacres de septembre 1792. C’est à raison que les candidats à la succession de Montmorin ne se bousculaient pas.
Le ministère Dumouriez
À partir du 15 mars 1792 commence l’époque des ministères girondins, avec Roland comme ministre de l’intérieur, et un militaire comme ministre des affaires étrangères: Dumouriez.
Dumouriez n’était pas un inconnu dans les services du ministère puis qu’à l’époque de Louis XV on lui avait confié des missions en Corse, en Pologne et en Suède. Cette dernière mission s’était mal terminée pour lui: alors qu’il avait été envoyé par le Secret du roi, il fut emprisonné par le ministre d’Aiguillon en raison de malversations et resta six mois à la Bastille. Il était l’auteur en 1791 d’un mémoire sur l’organisation du ministère lu aux Jacobins, ce qui le conduisit à la place de ministre.
C’est cette date du 15 mars 1792 qui marque véritablement la rupture entre Ancien régime et Révolution au sein du ministère. Une purge est réalisée. Les premiers commis des deux bureaux politiques, Gérard et Hennin, sont renvoyés, ou poussés à la démission. Il en est de même de quelques commis, dont les commis principaux. Goffinet se trouve être le plus gradé (ou pour mieux dire le plus ancien dans le grade de commis) de ceux qui restent dans les deux départements d’expédition politique.
Le seul premier commis à rester est le chef des archives qui étaient restées à Versailles, M. de Sémonin. Frédéric Masson, l’auteur du Département des affaires étrangères pendant la Révolution se plaît à rapporter un pamphlet dont il était l’objet :
« Il y a un de vos burau sur lequel vous n’avez pas porté vos regards ou il règne la plus affreuse aristocratis, le tems que j’ai abbite Versailles ma mi apportée de savoir que Ion socupe plus souvent au depôt des Affaires étrangères a faire des extraits pour le Journal de la Cour et de la Ville, la Gazette de Paris et l’Amie du Roi, que des affaires de la nation. Je vous dénoncé surtout le chef de ce bureau comme le plus enragé de tous les aristocrate; la preuve de ce que javance c’est que rien na pu encore le forcer a prendre la cocard nationale et il ne reçoit de journaux que ceux ci-dessus nommés avec le Journal de Genève, le Journal général de France, il a lu peu de tan le Moniteur, mais la lecture de ce journal lui donnais des convultions, il y a quelque chose de pire que tout cela, c’est que Monsieur Simonin qui coute 24 à 30 mille livre par an à la nasion, ne fait pas dans le courant de son année pour 24 livre de travail a payer très généreusement, il n’ecrit surement pas pour le service de son bureau la valeur d’un caier de paier a lettre il socupe mais cest a sa campagne a planter et a taillier des arbres et a chasser dans son parc voilla ses occupasion de toute l’année. Il vient à Versaille tout les huit jours des foit tout les trois semains quelquefois un mois, il arrive le matain a onze heures et repart a deux le même jour et retourne diner a sa campagne. Il est indigne pour la nasion de payer une personne aussi cher qui la serve aussi malle et cy peu et qui fait des veux pour voir tout les patriote mordre la poussière. » [82]
Et l’auteur de la dénonciation de demander le poste…
L’assemblée, avec toujours le comité diplomatique, tend à vouloir une transparence totale sur tous les actes du ministère. Ce qui est secret lui semble suspect. Néanmoins elle a maintenant un ministre qui ne lui parait pas être un ennemi. Le directeur nommé par Dumouriez, nommé Guillaume Bonnecarrère, prétendit qu’à son arrivée, il fut chargé d’organiser le ministère et donc « de démettre les commis courbés sous le joug du despotisme, et de les remplacer par les jacobins passionnés pour l’égalité… Le système politique fut changé, et déjà le 20 mars, quatre jours après ma nomination, au style rampant de l’esclavage succéda l’idiome de la liberté. »[83]
Aux deux bureaux politiques (du nord et du sud) sont substitués six bureaux, chacun chargé de la correspondance avec un petit nombre de pays. La répartition semble avoir été réfléchie: on conserve dans chaque bureau un ou deux anciens commis, mémoire du service, et on adjoint des membres des jacobins, dont on est sûr politiquement. Dumouriez place uniquement des gens qu’il connaît aux postes de chef de bureau. Choiseul ne faisait-il pas la même chose ?
Goffinet est affecté au 6e bureau, chargé de la correspondance avec l’Espagne et le Portugal. Le bureau a un chef et trois commis. Goffinet est le seul de l’ancienne administration. Les deux autres commis sont des jacobins, dont un prêtre marié. Son chef de bureau s’appelle Jean-Pierre Mendouze. Cet orateur jacobin finira guillotiné le 14 prairial an II, accusé de complicité avec Dumouriez[84].
La France déclare la guerre à l’Autriche le 20 avril 1792. Dumouriez passe au ministère de la guerre le 13 juin 1792, et aura le destin qu’on sait (victoire de Valmy, puis passage à l’ennemi). Plusieurs ministres assurent l’intérim, mais c’est Bonnecarrère qui dirige, comme il le dit lui-même: « le département que je dirigeais resta pur et invariable dans ses plans, malgré les changements de ministres. »
Convention
Déménagement du ministère et vues de Paris
A partir de la suspension du roi le 10 août 1792, c’est Lebrun-Tondu, girondin qui jusque-là dirigeait un des bureaux, qui devient ministre des affaires étrangères. Il le restera jusqu’à la chute de son parti le 2 juin 1793. La fin officielle de la royauté ne provoque quasiment pas d’épuration dans les bureaux: elle a déjà été faite. Seul Bonnecarrère, le directeur, fut arrêté comme suspect de complicité avec la cour. Il se défendra pourtant d’avoir jamais parlé ni montré une dépêche au roi.
Il faudra plus de temps pour que l’épuration soit faite dans les représentations étrangères. Le secrétaire de l’ambassade de Constantinople écrivit le 10 octobre 1792 après avoir reçu une brochure sur la suspension du roi: « J’ai remis, Monsieur, les pièces arrivées ici… à Monsieur le comte de Choiseul-Gouffier, mon chef, qui les a déposées dans un carton où s’ensevelissent toutes les dépêches contraires aux principes qui doivent animer tous bons et fidèles sujets du roi. Ce sera le sort de toutes celles qui me parviendront de votre part. »[85]
Le 2 novembre 1792 le ministère effectue le déménagement prévu quelques mois auparavant pour s’installer rive droite, rue Cerutti (aujourd’hui rue Laffitte) assez loin du domicile de Goffinet.
Alors qu’à Versailles il habitait à côté du ministère, il est maintenant à 40 minutes de marche. La marche dans Paris est une activité salissante et dangereuse[86]. Les trottoirs sont rares. Le pavé n’est pas parfait, il est parfois posé sur la boue, et il est parfois volé[87]. Certains habitants créent des marches d’escalier dangereuses devant leur porte. Il faut s’écarter lorsque les cochers qui mènent les cabriolets crient « Gare ! ». Il faut faire attention lorsque l’on descend du haut du pavé à cause d’un vendeur à la sauvette, d’un reflux d’eau d’égout ou d’un autre empiètement sur la chaussée. Les voitures rapides et légères, sans frein efficace, tuent et estropient. Elles font l’objet d’un grand nombre de plaintes de la part des parisiens et même de pétitions devant l’assemblée nationale. La voiture homicide est un topique littéraire à l’époque. Heureusement pour les piétons, les embouteillages -on dit les embarras- sont fréquents et font diminuer la vitesse.
L’absence de trottoirs est également préjudiciable à la propreté des vêtements. Il existe des décrotteurs de métier que l’on peut payer pour nettoyer ses chaussures, c’est d’ailleurs un sujet de plaisanterie:
« Tout tend à la perfection, tout, jusqu’à l’art du décrottage.
Il y a quelques années, un Savoyard mal-adroit, un grossier Auvergnat brossait rudement les souliers sans épargner les bas, et noircissait quelquefois ces derniers aux dépens des autres, avec de l’huile puante mêlée à un peu de noir de fumée; aujourd’hui, un ARTISTE, muni d’une éponge et de trois ou quatre pinceaux de diverses grosseurs, effleure la chaussure, en enlève à peine la boue, et recouvre le tout d’un cirage noir et brillant. »[88]
Il vaut mieux donc s’habiller de couleur sombre lorsque l’on est victime de giclées de boue. Goffinet n’a pas de voiture, cela impliquerait de posséder une écurie, d’assurer un approvisionnement en eau et en avoine et cela est donc réservé à plus riche que lui. L’inflation des fourrages, la pénurie de chevaux à la suite des réquisitions dues à la guerre, ainsi que l’émigration d’une bonne partie de la noblesse font que dans ces années 1793 et 1794, il y a probablement moins d’attelages. Il y a également des journées sans voitures: les rues parisiennes furent ainsi proscrites aux fiacres le 10 août 1793 pour la commémoration de la chute de la royauté[89].
Les chaises à porteur existent toujours, mais tendent à disparaître. Il existe également des fiacres. Peut-être Goffinet en emprunte-t-il un.[90] Cet ancêtre des taxis a été déréglementé en 1790, et les prix doivent être abordables pour lui. Mais en 1795 il se décrira d’une constitution robuste, à 65 ans. Cela peut être dû aux bénéfices de la marche.
Entre deux mouvements d’évitement des dangers de la rue, il a l’occasion de méditer sur le paysage qu’il traverse, bouleversé et imprévisible depuis le début de 1789.
Deux itinéraires sont possibles lorsqu’il quitte son domicile de la rue Dominique (anciennement Saint Dominique). Au bout de la rue du bac, il n’a heureusement pas à prendre le bac puisqu’il peut prendre le pont royal, renommé pont national. Puis il passe devant le pavillon de l’égalité (extrémité des Tuileries qui est aujourd’hui le pavillon de flore, partie du Louvre) dans lequel travaille les Comités, dont le Comité de salut public. Il longe ensuite les Tuileries dans le jardin national. Il peut y croiser des députés se rendant à la Convention. Il prend enfin la rue de la Montagne, près de l’église Saint Roch désaffectée fin 1793 comme toutes les églises de Paris et de la « Société populaire des amis de la liberté et de l’égalité » (club des Jacobins, en face de la Convention de l’autre côté de la rue Honoré).
Goffinet peut aussi longer l’ancien palais Bourbon confisqué au prince de Condé puis emprunter le tout nouveau pont Louis XVI achevé en 1791 (avec, dit-on, des pierres de la Bastille) renommé en 1792 pont de la Révolution et appelé aujourd’hui pont de la Concorde. Goffinet passerait alors place de la Révolution (aujourd’hui Concorde) où Louis XVI fut guillotiné le 21 janvier 1793. La guillotine sera placée à proximité de l’entrée du jardin des Tuileries à partir de mai 1793 jusqu’au début de la grande terreur en juin 1794 (elle est alors déplacée place de la nation), puis de nouveau pour exécuter les robespierristes (10 thermidor an II – 28 juillet 1794). Il passerait ensuite devant l’église de la Madeleine, dont la construction a été arrêtée: ce qui en a été bâti est un bien national loué à des artisans et des marchands.
Nouvelle organisation
La correspondance avec les consulats qui restent passe du ministère de la guerre à celui des affaires étrangères. Le 6e bureau est fusionné avec le 4e. Sous la direction de Jean-Victor Colchen, il est chargé de la correspondance avec l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Goffinet est le seul ancien de ce bureau dans lequel il y avait trois autres commis. Le nombre des commis a considérablement augmenté depuis 1789, puisqu’il est passé de quarante et un à soixante-dix-huit, alors qu’il paraît vraisemblable que le volume de correspondance n’a pas augmenté. Beaucoup sont entrés par protections diverses (il y a par exemple l’oncle du directeur Bonnecarrère)[91].
Les usages diplomatiques changent. Le papier à entête doit être illustré aux armes du nouveau régime. Le tutoiement révolutionnaire s’installe progressivement, ainsi que le qualificatif de citoyen et des salutations sous forme de « salut et fraternité ».
Goffinet a peut-être été chargé de la correspondance avec l’Espagne. L’Espagne garde encore quelques temps des relations diplomatiques. Mais le procès et l’exécution de Louis XVI firent basculer l’Espagne du côté des ennemis de la France. L’Espagne essaya de corrompre ses juges en versant des fonds. En janvier, Charles IV n’hésita pas à promettre sa neutralité en échange de la vie de Louis XVI. En réponse, Danton proposa qu’on déclare la guerre à l’Espagne. Le roi d’Espagne offrit encore sa neutralité contre la vie de Marie-Antoinette et de ses enfants. En réponse, Barère déclara à la tribune qu’il fallait porter la liberté « sous le plus beau climat et au peuple le plus magnanime d’Europe ». Le 7 mars, la France déclara la guerre à l’Espagne. « Un ennemi de plus pour la France est un triomphe de plus pour la liberté ! » conclut Barère[92]. Depuis la mort de Louis XVI, la plupart des pays étrangers ont retiré leurs ambassades. Ils sont dans une situation de guerre ouverte ou de neutralité méfiante.
Le 2 juin 1793, le ministre Lebrun-Tondu est arrêté avec les députés girondins de la Convention (Brissot, Pétion et al.) et sera guillotiné en décembre 1793. Trois de ses chefs de bureau finiront guillotinés pendant la « Grande terreur » de juin et juillet 1794 qui précède la chute de Robespierre[93]. Et on verra que les autres étaient peut être menacés à cette date.
Goffinet prête sûrement le deuxième serment de la Révolution, comme tous les employés: « être fidèle à la nation, maintenir la Liberté et l’Égalité, ou mourir en les défendant. »
Et il obtient à cette période une indispensable carte de sûreté datée du 29 pluviôse (28 juillet 1793) : « Le citoyen Goffinet, employé aux relations extérieures depuis 41 ans sans interruption n’est ni noble ni étranger. Son certificat de civisme en règle est du 29 pluviose. Il est connu du Patriote Heussé administrateur de police et membre du Conseil général de la commune.
An II »[94]
On peut y lire la seule description physique que l’on ait de lui : « âgé de soixante-trois ans… taille de cinq pieds trois pouces (0) lignes, front élevé, cheveux blancs, sourcils gris, yeux bleus, nez petit, bouche moyenne ». Cinq pieds trois pouces et zéro ligne font en mesures actuelles 1 mètre 70.
Ce « patriote Heussé »” est Florent Heussé, « fabricant de chocolat » devenu administrateur de la police de Paris, et représentant au sein de la municipalité de la section à laquelle appartient Jacques Goffinet: la Section de la Fontaine-de-Grenelle[95]. La section se réunissait dans l’église Saint-Thomas-d’Aquin, ancienne église des dominicains qui devint église paroissiale, puis fut désaffectée. Goffinet s’est probablement rendu à des réunions et s’y est fait connaitre.
C’est François-Louis Deforgues qui fut le dernier ministre sous la Convention montagnarde, avant que le ministère ne soit remplacé par une commission. Ancien du ministère de la guerre, il amène avec lui un secrétaire général nommé Miot, plus tard comte d’Empire, qui a écrit des mémoires particulièrement intéressantes.
Miot écrit à propos de son changement de ministère: « Un revers de nos armées, un oubli, une négligence qui auraient donné lieu à la moindre dénonciation pouvaient me perdre sans retour, et je désirais vivement sortir d’une situation aussi critique… J’avais calculé que, les relations extérieures de la France étant pour le moment à peu près nulles, je serais moins en vue et moins exposé dans un département, pour ainsi dire sans occupations, que dans l’administration de la guerre qui attirait alors toute l’attention. »[96]
Miot va donc aux affaires étrangères pour ne faire à peu près rien, et c’est le meilleur moyen de sauver sa carrière et peut-être sa vie ! La discrétion était déjà une qualité appréciée chez les commis sous l’ancien régime, on peut penser que les employés continuent pour d’autres raisons à se faire discrets. Miot est séduit par leurs mœurs : « Aux formes grossières, adoptées dans les bureaux de la guerre, succédaient la politesse et l’élégance des manières, résultat d’une éducation distinguée et de l’habitude des relations avec des étrangers. Je retrouvais là les traces des anciens usages de la monarchie qui subsistaient encore dans ce département. »
C’est Danton, qui au sein du premier Comité de Salut public, est chargé des relations extérieures. Miot en témoigne: « J’eus plusieurs fois, dans cet intervalle de temps, l’occasion de voir Danton, le patron de Deforgues, et qui venait fréquemment dîner chez lui où j’étais assez souvent invité, ainsi que mes collègues Otto et Colchen. A ces dîners se trouvaient aussi Lacroix, Legendre, Fabre d’Églantine, Camille Desmoulins et plus rarement Robespierre avec lequel je ne me rencontrai qu’une seule fois. »
Ensuite c’est Barère qui dans le Comité de Salut public dominé par Robespierre (à partir de juillet 1793) est chargé des relations extérieures. Il écrit dans ses mémoires dans lesquelles il cherche en général à diminuer son rôle, que cela ne lui prenait que très peu de temps: « Les relations extérieures m’occupaient peu ; il n’y eut à traiter que l’alliance de la Suède, des Etats-Unis, de la Porte-Ottomane et de la Suisse ; tout le reste de l’Europe était hostile et armé contre la France. Ces objets étaient d’ailleurs travaillés dans les bureaux des ministres, et il y avait peu de choses à faire ou à délibérer. »[97]
Il faut d’ailleurs noter que ces « alliances » étaient surtout des neutralités.
Miot écrit plus loin: « Je passai le reste de l’année 1793 (le commencement de l’an II) remplissant les fonctions de secrétaire général du ministère des affaires étrangères et je profitai des loisirs assez longs que me laissait cette place dans un temps où nous n’avions presque point de relations à l’étranger, pour compulser les archives de ce département et y puiser un genre d’instruction que je n’avais pas, jusque-là, eu l’occasion d’acquérir. »[98]
Il y a donc sans doute peu d’activité au ministère, il n’y en a pas moins de la peur quand le gouvernement se souvient de son existence: « … je me rappelle que ce ne fut pas sans une sorte d’effroi que M. Colchen, qui était à la tête de la division du ministère dont les Ligues suisses font partie, se vit appelé chez le ministre à une conférence où se trouvait Robespierre. »[99]
Colchen, le chef de Goffinet, raconte en effet dans ses mémoires qu’il refusait de se compromettre, mais qu’il fut très surpris de sa rencontre avec Robespierre au ministère : « Robespierre y vint. Je fus appelé: on nous laissa seuls. Il se montra fort poli. Comme lui, j’étais peigné, poudré et dans un costume qui n’était pas celui du temps. Il m’appela Monsieur et non citoyen, et s’abstint de me tutoyer : j’en usai de même à son égard. J’entrai en matière. Je passai en revue tous les gouvernements avec lesquels nous avions conservé des relations. J’exposai verbalement nos rapports avec chacun d’eux… »[100]
Le 2 ventôse (20 février 1794), Deforgues fit définitivement ordonner l’installation du ministère dans l’hôtel Gallifet, rue du Bac, faubourg Saint-Germain, « afin de ranimer ce quartier et de donner de la valeur aux superbes édifices que la nation y possède »[101]. Le quartier était en effet déserté, nombre d’hôtels et de biens ecclésiastiques ayant été confisqués aux émigrés. Le déménagement n’eut lieu que vers le mois de septembre. Le ministère y resta jusqu’à la Restauration.
On trouve au milieu de la comptabilité de ces années[102] là un précieux document décrivant l’organisation du travail dans la 4e division. Colchen, le chef, est chargé des instructions aux agents, de la correspondance politique, la distribution du travail, la surveillance. Goffinet, sous-chef, a pour mission: « le chiffrement et déchiffrement, la composition et l’ordre des cartons, la collation des dépenses, leur envoy, le dépôt des Lois et des décisions et arrêtés du comité de Salut public, les circulaires pour l’envoi des Lois. » Son traitement annuel passe à 6000 livres. Les autres commis sont spécialisés dans la correspondance soit avec les agents diplomatiques, soit avec les consuls, en Suisse et en Italie. Soit l’Espagne et le Portugal ont été confiés à un autre bureau, soit ils ne sont pas mentionnés car la France est engagée dans la guerre du Roussillon (mars 1793 à juillet 1795).
La thèse que Deforgues, comme d’autres conventionnels ou ministres, ait pu toucher des fonds de l’Angleterre a été défendue[103]. On sait en tout cas que l’Angleterre avait des complicités dans le ministère, elle cherchait par tout moyen à empêcher le soutien de la France aux Irlandais rebelles et peut-être à désorganiser le gouvernement, par exemple par des recrutements intempestifs.
Mais c’est le Comité de salut public qui prenait le pouvoir et cela devint officiel: le ministère disparut en tant que tel et fut remplacé le 12 germinal II (1er avril 1794) par une Commission de relations extérieures, chargée d’exécuter les décisions du Comité de salut public. Entre temps Deforgues fut arrêté comme dantoniste, mais fut libéré après thermidor.
La Commission aux relations extérieures
Le 29 germinal an II (18 avril 1794), Philibert Buchot est nommé Commissaire aux relations extérieures. Il est probablement désigné sur les conseils de René-François Dumas, le président du Tribunal révolutionnaire.
Buchot est un personnage peu connu, comme à peu près tous les commissaires nommés, excepté Herman l’ancien président du tribunal révolutionnaire, qui fut nommé Commissaire des administrations civiles, police et tribunaux (équivalent de ministre de l’Intérieur et de la justice). Mais le but avoué de Carnot, rapporteur de la loi qui supprimait le conseil exécutif avec ses six ministères pour instituer douze commissions, étant de supprimer le pouvoir exécutif, il n’est guère étonnant de ne voir nommer aucune personnalité politique majeure. Buchot avait été recommandé à Robespierre, qui rédigea son arrêté de nomination, en espérant sans doute qu’il n’aurait aucune velléité d’indépendance.
Voici ce qu’écrira Miot du nouveau commissaire: « Il arrivait du département du Jura où il avait été maître d’école dans une petite ville. Son ignorance, ses manières ignobles, sa stupidité surpassaient tout ce que l’on peut imaginer. Pendant les cinq mois qu’il fut à la tête de ce département, il ne s’en occupa nullement et était incapable de s’en occuper. Les chefs de division avaient renoncé à venir travailler avec lui: il ne les voyait ni ne les demandait. On ne le trouvait jamais dans son cabinet, et quand il était indispensable de lui faire donner sa signature pour quelque légalisation, seuls actes auxquels il avait réduit ses fonctions, il fallait aller la lui arracher au billard du café Hardy où il passait habituellement ses journées. »[104]
Buchot était pourtant un ancien avocat et ses quelques écrits montrent qu’il n’était pas ignare. Mais il est vrai qu’il se conforma à ce que le Comité de Salut public attendait de lui : il ne joua pas le rôle de ministre, et ne fit quasiment rien[105]. Et une fois devenu Commissaire à sa place, Miot ne jouera pas non plus de rôle politique majeur.
A ce moment-là le 4e bureau où travaille Goffinet et dont le chef est Colchen est toujours chargé de la Suisse et de l’Italie (Rome, Naples, Venise, Gênes, le Piémont et la Sardaigne). Ils sont onze pour ce travail. Les trois autres bureaux politiques étant aussi peuplés, il y a trente-neuf employés contre dix-neuf en 1789[106].
Peu d’activité et un grand nombre d’employés, cependant l’oisiveté est mal vue des terroristes. Dès avant l’arrivée du Commissaire, le Comité de salut public avait prévenu dans une déclaration du 18 Germinal, de la main de Saint-Just: « informé que depuis le décret qui supprime les ministres, et lui substitue des commissions, les affaires sont négligées par les employés du ministère, moins sensibles à l’intérêt public qu’à leur intérêt personnel, le Comité de salut public déclare que, conformément aux décrets de la Convention nationale, il poursuivra selon la rigueur des lois tout agent du gouvernement qui aurait négligé ses fonctions et compromis le service, jusqu’à l’établissement des commissions. »[107]
Saint-Just avait d’ailleurs la plume acerbe envers les fonctionnaires:
« Plus les fonctionnaires se mettent à la place du peuple, moins il y a de démocratie. »
« Depuis qu’il y a dans les sociétés [populaires], trop de fonctionnaires, trop peu de citoyens, le peuple y est nul. Ce n’est plus lui qui juge le gouvernement, ce sont les fonctionnaires coalisés qui, réunissant leur influence, font taire le peuple, le séparent des législateurs qui devraient en être inséparables et corrompent l’opinion dont ils s’emparent et par laquelle ils ont font taire le gouvernement et dénoncent la liberté même. »
« Tous ceux qu’emploie le gouvernement sont paresseux, tout homme en place ne fait rien par lui-même et prend des agents secondaires; le premier agent secondaire a les siens, et la République est en proie à vingt mille sots qui la corrompent, qui la combattent, qui la saignent. Vous devez diminuer partout le nombre des agents, afin que les chefs travaillent et pensent.
Le ministère est un monde de papier. Je ne sais point comment Rome et l’Egypte se gouvernaient sans cette ressource; on pensait beaucoup, on écrivait peu. La prolixité de la correspondance et des ordres du gouvernement est une marque de son inertie: il est impossible que l’on gouverne sans laconisme. Les représentants du peuple, les généraux, l’administration sont environnés de bureaux comme les anciens hommes de palais. Il ne se fait rien et la dépense pourtant est énorme. Les bureaux ont remplacé le monarchisme; le démon d’écrire nous fait la guerre et l’on ne gouverne point. »[108]
On ne s’étonnera donc pas que le 12 prairial II (1er juin 1794) le Comité de salut public prenne un arrêté particulièrement sévère pour soutenir l’activité. Il a l’idée de faire embaucher un employé supplémentaire, pour contrôler les autres employés:
« Le Comité de salut public, considérant la nécessité de donner au travail des bureaux des douze Commissions exécutives l’activité la plus soutenue, arrête ce qui suit : 1° Il sera nommé par chaque Commission un citoyen chargé de rendre compte journellement au commissaire de chacune d’elles de l’exactitude de tous les employés à se trouver ponctuellement à leurs bureaux, aux heures qui seront indiquées ci-après. Ce citoyen n’exercera dans les bureaux aucune autre fonction, et son traitement sera de 2400 livres par an. »[109]
On se demande ce que ce citoyen faisait entre les heures d’arrivée et celles de départ ! Un contrôleur des pointages fut effectivement nommé à cette éminente fonction au sein de la commission des relations extérieures le 1er brumaire II: Louis-Gabriel Pigneux, ancien menuisier[110]. Les commis n’échappent pas facilement à leurs fonctions. Le même acte définit précisément le temps de travail, ou de présence:
« — 2° Aucun employé dans les bureaux ne pourra quitter ses fonctions actuelles pour d’autres sans en avoir obtenu la permission du Comité de salut public, et les commissaires qui présenteront au Comité les démissions proposées seront responsables de la légitimité des motifs sur lesquels elles sont fondées.
— 3° A compter du 21 prairial, présent mois, les employés dans les bureaux des Commissions et Agences qui en dépendent seront tenus d’être à leur poste depuis huit heures précises jusqu’à deux heures après midi, et le soir depuis cinq heures précises jusqu’à huit heures et demie.
— 4° Les jours de décade, les employés seront dispensés de se rendre le soir à leurs bureaux.
— 5° Les heures d’audience pour le public seront depuis midi jusqu’à deux heures seulement, et les commissaires, de concert avec les chefs de bureaux, aviseront aux mesures nécessaires pour éviter l’affluence dans les bureaux, et pour faciliter à chaque citoyen les moyens d’être envoyé directement et de suite aux bureaux où il aura affaire, et d’y être promptement entendu
— 6° Le citoyen chargé de veiller à l’exactitude des employés à se trouver à leurs bureaux le sera également de tenir la main à la police des garçons de bureau, et à ce que chacun d’eux se tienne exactement à son poste… »
Cela fait 9 heures de travail par jour, avec une seule après-midi de repos (après une matinée de 6 heures) tous les dix jours (la semaine étant remplacée par des décades dans le calendrier républicain).
L’exagération de Miot au sujet de la stupidité du Commissaire Buchot autorise à douter de ses allégations contre lui. Il prétend que Buchot avait dénoncé comme modérés tous les chefs de bureau le 8 thermidor et les avait nargués avec un sourire cruel. Mais ils étaient certainement menacés:
« Du reste, cet homme, si nul pour les affaires, était d’une funeste activité, lorsqu’il s’agissait de seconder les fureurs du parti de Robespierre qui l’avait fait nommer comme ami du président du tribunal révolutionnaire et nous ne fûmes pas longtemps à nous apercevoir des effets de la haine qu’il portait à mes collègues et à moi. Lorsque Robespierre, menacé par une partie de la convention, multiplia le nombre des victimes qu’il sacrifiait chaque jour pour diminuer celui de ses ennemis, Buchot nous dénonça comme des modérés dont on ne pouvait trop promptement se défaire. Il fit décerner, le 8 thermidor de l’an II (27 juillet 1794), par le comité de sûreté générale un mandat d’arrêt contre Otto, Colchen, Reinhard et moi. »
Buchot resta quelque temps après la chute de Robespierre, jusqu’au 18 brumaire an III (8 novembre 1794). La passation de pouvoir décrite par Miot est une des plus étranges que l’on puisse concevoir:
« Par un décret de la convention du 18 brumaire an III (8 novembre 1794), je fus nommé commissaire des relations extérieures. MM. Otto, Colchen et Reinhard furent attachés particulièrement au comité de salut public, pour suivre près de lui les détails ainsi que la correspondance diplomatique, et je vins m’établir dans l’hôtel où le ministère des affaires étrangères, comme je l’ai déjà dit, avait été transféré depuis deux mois.
Ces divers arrangements s’étaient opérés à l’insu de Buchot qui n’en fut instruit que par un journal qu’il acheta le soir dans la rue. Je me rendis cependant près de lui le lendemain de ma nomination et je lui témoignai les égards d’usage en pareille circonstance. Mais il y parut très-peu sensible. Il me dit seulement qu’il allait se trouver fort embarrassé, si j’exigeais qu’il quittât immédiatement le logement qu’il occupait dans l’hôtel. Je l’assurai que, n’étant pas dans l’intention de venir y coucher, je lui en laisserais la jouissance aussi longtemps qu’il ne se serait pas procuré une autre habitation. Il me remercia et me dit qu’on avait bien fait de me nommer, mais qu’il était fort désagréable qu’on l’eût fait venir à Paris et forcé à quitter son état en province, pour être ainsi laissé sur le pavé. Là-dessus il imagina de me demander une place dans mes bureaux.
J’essayai de lui faire sentir toute l’inconvenance qu’il y aurait à le faire descendre à un poste secondaire dans la même administration où il avait tenu le premier rang. Il trouva ce genre de délicatesse fort étrange, et, voyant que j’hésitais à lui répondre affirmativement, il me dit que, dans le cas où je ne le trouverais pas capable de remplir la place de commis qu’il sollicitait, il se contenterait de celle de garçon de bureau.
Je rougis pour lui de tant d’avilissement, et après quelques mots vagues d’excuse je le quittai »[111].
Buchot retourna donc à des emplois subalternes à l’octroi, et Miot devint Commissaire. En sus des bureaux de la Commission, le Comité de Salut public créa ses propres bureaux, chargés d’expédier ses dépêches. Il recruta parmi le personnel de la Commission.
Goffinet reste à la Commission des relations extérieures. Il devient sous-chef du premier bureau, « chargé de la correspondance pour les affaires consulaires et commerciales, les affaires contentieuses et particulières, l’économie politique, les sciences, arts et découvertes utiles en pays étrangers, avec la Suisse, l’Italie, l’Espagne et le Portugal. »
On voit que dans ses fonctions, on ne compte pas la correspondance politique. Sous le Comité de salut public thermidorien, les relations diplomatiques sont ranimées (États-Unis avec l’ambassade du futur président Monroe, République de Genève, états italiens…), et on fait lever les scellés sur les biens des ambassadeurs étrangers. Mais ce sont donc les bureaux du Comité qui se chargent de la correspondance politique et de la rédaction des traités de paix, et non ceux de la Commission. Le Comité donna par exemple directement ses consignes à François Barthélémy, ambassadeur en suisse (et futur Directeur), qui signa plusieurs traités de paix en 1795.
Miot confie surtout à ses bureaux de la Commission un travail de documentation: « Des consuls furent envoyés dans tous les pays où l’on pouvait espérer de les faire recevoir. Une circulaire adressée aux agents extérieurs de la république leur recommanda de mettre au premier rang de leurs devoirs les recherches sur l’état des sciences, des arts et en général des connaissances humaines dans les pays où ils exerçaient leurs fonctions… Je fis venir les ouvrages et les journaux qui paraissaient en pays étranger et formai le dessein de fonder une bibliothèque et une salle de lecture qui, établies dans l’hôtel de la commission, seraient ouvertes à tous ceux qui voudraient y venir puiser des renseignements. »[112]
On continue donc avec les pratiques de renseignement de l’ancien régime qu’on a vu avec les tables de correspondance. Le chef de ce premier bureau est Rosenstiel, un ancien traducteur recruté du temps de Vergennes, qui avait été réformé par Dumouriez, et qui était revenu probablement grâce à sa connaissance des langues.
Miot accepte ensuite un poste de consul, considéré comme plus élevé que le poste de commissaire des affaires étrangères. C’est dire s’il n’est pas un vrai ministre. Colchen le remplace jusqu’à la fin de la convention thermidorienne.
La situation matérielle des commis se dégrade, mais peut-être pas plus que celle de la population parisienne[113]. Les prix augmentent, et à partir de l’an III, les salaires sont versés en assignats (d’abord 30 livres assignats pour une livre). Puis en l’an IV, ils sont versés avec leurs successeurs: les mandats territoriaux, qui connaissent aussi une dévaluation spectaculaire. Les salaires sont augmentés en proportion importante, sans toutefois compenser la perte subie.
Goffinet continue à verser la rente de 1000 livres à son gendre Despréaux, en revanche il cesse tout versement anticipé de la succession à l’autre gendre Regnault.
Période de réforme : le ministère Delacroix sous le Directoire
À l’avènement du Directoire (4 brumaire an IV – 26 octobre 1795), le bureau du Comité de Salut public chargé des affaires extérieures et la Commission furent fusionnés pour former de nouveau un ministère. Charles Delacroix fut nommé ministre des Relations extérieures le 5 novembre 1795. Sous le régime de la nouvelle constitution, les ministres sont nommés et révoqués par les directeurs, ils ne dépendent pas du Parlement.
Delacroix reçoit pour consigne de diminuer le nombre des employés du ministère. Jacques Goffinet, qui avait traversé tous les régimes, est alors réformé le 21 frimaire IV (12 décembre 1795). Sa fille prétendra après sa mort qu’il avait été réformé à cause de ses opinions royalistes. Il est vrai que le 13 vendémiaire IV (5 octobre 1795) une insurrection royaliste avait éclaté à la suite des décrets des « deux tiers », qui visait à maintenir une majorité républicaine au sein des Conseils. L’insurrection fut réprimée par Barras et Bonaparte, et à la suite de la mise en place du Directoire, on renvoya les employés susceptibles de sympathie avec un retour de la monarchie. Le Directoire ordonna un contrôle strict et une épuration. Dans le dossier du gendre Despréaux au ministère de l’intérieur on trouve par exemple la mention qu’il ne figurait pas au nombre des manifestants: « à son poste le 13 vendémiaire »[114].
Cependant les lettres de Delacroix ne vont pas dans le sens d’une réforme de Goffinet pour raison politique. Telle par exemple, celle dans laquelle il demande au ministère de l’intérieur le versement d’une pension:
« Pour concilier, autant qu’il a été possible, la justice, avec l’exécution de l’ordre que vous m’avés donné par votre lettre du 2 frimaire dernier de réduire au strict nécessaire le nombre des employés dans mes bureaux j’ai jugé convenable de comprendre dans la réforme le citoyen Goffinet que les longs services mettent dans le cas de jouir de la pension de retraite, afin de conserver à sa place un individu qui n’aurait pas le même droit. Le Ministre de l’intérieur doit incessamment mettre sous les yeux du Directoire son travail relatif aux pensions de retraite. Les bons témoignages qui m’ont été rendus du zèle de l’exactitude et de la fidélité avec lesquelles le citoyen Goffinet a constamment rempli ses devoirs dans les bureaux du Ministère qui m’est confié, me persuadent que vous voudrez bien, Citoyens Directeurs, faire éprouver à ce père de famille avancé en âge les effets de la reconnaissance que la nation accorde à ceux qui l’ont bien servie, pendant quarante quatre années sans interruption dans le même bureau. Cette récompense sera d’ailleurs une perspective encourageante pour ceux qui comme lui pourront fournir avec honneur une carrière aussi longue dans la partie diplomatique. »
(Non daté)
Delacroix ne fait pas dans le détail et ses réformes sont même critiquées dans la presse:
« Dès votre entrée au ministère, vous en avez chassé, citoyen ministre, tout ce qu’il y avait de talent, un assez grand nombre de patriotes irréprochables, même après vendémiaire. Je ne citerai que les citoyens Colchen, Otho, Baisse et Goffinet… Vous vous êtes tellement isolés, qu’aujourd’hui toute tradition se trouve perdue, tous les fils rompus, et qu’on est le plus souvent forcé d’aller chercher au-dehors les formules les plus ordinaires de la diplomatie. »[115]
Commence une période très difficile pour Jacques Goffinet. Il est contraint de vendre ce qu’il a pour vivre. Il doit être humiliant pour lui de ne pouvoir assurer les obligations qu’il a contracté envers ses gendres pour le paiement de la dot de ses filles. Cela doit engendrer des difficultés pour toute la famille: le gendre Louis-Grégoire Despréaux ne gagne que 3.000 F en 1796 et 2.700 F en 1797 à son poste d’archiviste au ministère de l’intérieur[116].
Goffinet est obligé de faire de coûteux emprunts en attendant la liquidation de sa pension de retraite. Paris compte à l’époque un certain nombre de petits banquiers et de prêteurs sur gages. Le Mont-de-piété n’a pas été officiellement supprimé, mais en 1795, il est contraint de fermer à la suite de la dévaluation des assignats. Il sera ensuite réanimé sous le Consulat et Napoléon lui accordera même le monopole du prêt sur gages. En attendant il est supplanté par des « lombards », c’est à dire des usuriers à la fois banquier et prêteur sur gage. On s’en serait douté, ils ont très mauvaise réputation et la description de leur activité dans la littérature de l’époque est sordide:
« Il y a maintenant à Paris un très-grand nombre de maisons de prêts sur nantissement. Les 9, 19 et 29 de chaque mois, les marchands y portent des objets en dépôt afin d’avoir de quoi faire leurs paiemens: ce sont là les grands jours de prêts. Les 15 et 25, les détaillants, les femmes des halles, les commissionnaires, les petites fruitières, les filles publiques y déposent de petits articles, quelques hardes, un peu de linge, afin de pouvoir faire une mise à la loterie qui se tire le lendemain. La loterie tirée, la courtisane s’écrie: Je n’ai manqué l’ambe que de deux numéros ! Son linge se vend au Lombard à la fin du mois, et elle se trouve ainsi avoir joué à la loterie son avant-dernier jupon.
Un Prêteur sur gage m’a avoué qu’il avait prêté, en douze ou quinze fois différentes, 6 francs sur un mouchoir qui ne valait pas quinze sous. Il y a telle fille publique qui envoie, en se couchant, sa robe au Lombard voisin pour avoir à souper, et qui ne se lève que lorsqu’elle a de quoi en acheter une autre. Ces détails vrais font horreur; ce n’est pas ma faute: pourquoi y a-t-il des Lombards et des filles publiques ? »[117]
Goffinet prépare pourtant rapidement son « dossier de retraite » que le ministre transmet:
« 2 nivôse an IV de la République (23 décembre 1795)
Le ministre des relations extérieures au citoyen directeur de la liquidation
Je vous communique, Citoyen, la lettre que m’a envoyé le 30 frimaire (21 décembre) le citoyen Goffinet ci devant employé au département des relations extérieures et les pièces qui y sont jointes savoir:
[longue liste de certificats signés Hennin, Gérard de Rayneval et al.]
D’après d’aussi longs services et non interrompus, ce citoyen a droit à la reconnaissance nationale; je vous prie de mettre en sa faveur toute la diligence que vous inspirera votre justice. Ses appointements étaient de six mille livres de traitement fixes. »
Delacroix fait rechercher si ses débuts datent de 1756 ou de 1752, et atteste le 25 mars 1796 que la date à prendre en compte est bien 1752:
« Je soussigné Ministre des Relations extérieures atteste que, d’après vérification faite aux archives de mon département des dépêches des Ministres de France près la cour de Vienne depuis 1752 jusqu’en 1756 inclusivement, il résulte de la comparaison établie pour constater l’identité d’écriture réclamée par le citoyen Goffinet, ancien sous-chef d’un de mes bureaux, que ces dépêches sont en effet écrite de sa propre main.
En conséquence, d’après une preuve aussi manifestement acquise, et attendû le décès des Ministres sous lesquels ce citoyen a été employé dans la Secrétairerie de la Légation de France à Vienne pendant les cinq années précédemment énoncées, je lui ai délivré le présent certificat pour lui servir et et valoir envers qui il appartiendra.
A Paris ce 5 Germinal de l’an IV de la République une et indivisible.
Le Ministre des relations extérieures
CH D »
Delacroix relance encore son collègue le 14 juillet 1796:
« 26 messidor 4
Le ministre des relations extérieures au ministre de l’intérieur
Vous devez mettre sous peu, mon cher collègue, sous les yeux du directoire un travail sur les pensions de retraite, le citoyen Goffinet qui a des droits à être compris dans ce travail, par 44 ans de services sans interruptions dans les bureaux des R. ext. attend les effets de la reconnaissance nationale ! Ne pourriez vous pas hâter le moment qui doit fixer son sort indépendamment de ses bons et anciens services ? Ce citoyen père de famille est avancé en âge et ses besoins permettent peu d’ajourner plus longtemps les secours auxquels il a droit de prétendre. Je vous recommande vivement ses intérêts mon cher collègue et je vous prie d’accélérer le rapport que vous devez remettre au directoire sur les pensions de retraite
Salut et Fraternité
Charles Delacroix »
Goffinet est contraint de demander un secours qu’il lui est accordé sur les fonds du département, en même temps qu’à Hennin, l’ancien premier commis du temps de Vergennes. Le montant qui lui est accordé le 5 floréal an V (24 avril 1797) est très faible: 500 francs. Au moins ce secours est probablement versé en numéraire, les assignats et mandats ayant été abandonnés pour les versements de salaire.
Tout cela est d’autant plus humiliant qu’il devait être le personnage important de la famille. Les deux fils aînés de ses filles se prénomment Jacques, signe qu’il devait être le parrain. Louis “Félix” Jacques François Despréaux est né le 28 avril 1792, lorsque la dot était payée. Mais Jacques Amable Regnault naît le 27 vendémiaire an VII (18 octobre 1798) après que Goffinet eut traversé ces moments difficiles.
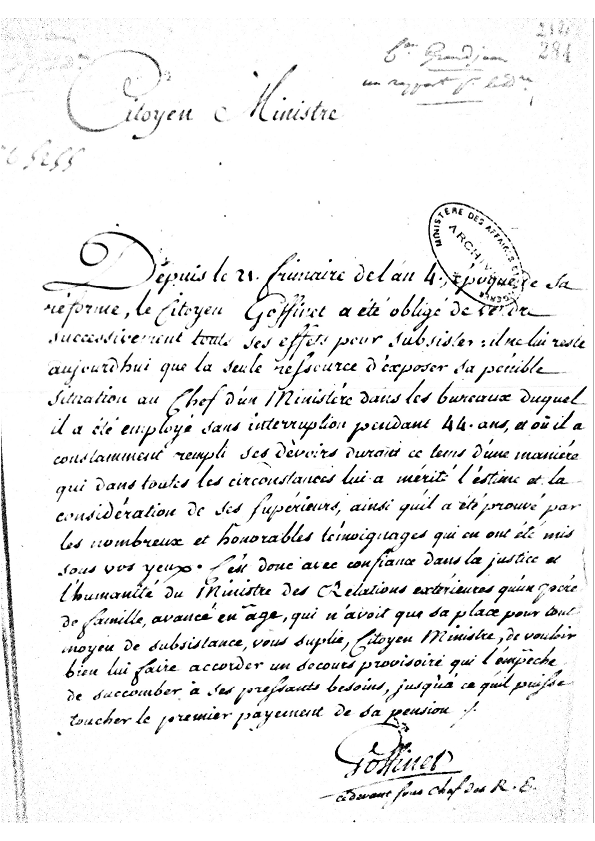
Demande de secours par Jacques Goffinet pendant sa période de réforme
Un rapport décrivant une gestion désastreuse du ministère Delacroix est lu par le député Barbé-Marbois à la séance du 16 prairial an V (4 juin 1797) du Conseil des Anciens. Le rapporteur disait qu’avec le triple d’employés, le ministère avait une correspondance moitié moins active qu’en 1789. Delacroix répond : « Nous avons enregistré 18,000 pièces en dix-neuf mois ». Il est vrai que le nombre de traités signés à cette période est important. Ils sont directement signés par Bonaparte ou par Moreau. Mais un remaniement ministériel le 27 messidor an V (15 juillet 1797) finit par avoir raison de Delacroix. Talleyrand est nommé ministre des Relations extérieures grâce au directeur Barras, et sans doute à Mme de Staël.
Juste avant de partir, sous la pression des Conseils, Delacroix a engagé la réforme d’un grand nombre de commis (plus d’une vingtaine). C’est l’occasion pour Goffinet de proposer ses services. Il remet au nouveau ministre un mémoire le 25 germinal VI (14 avril 1798):
« Le citoyen Goffinet, sous-chef d’une division politique des relations extérieures, a été réformé le 21 frimaire de l’an IV après quarante quatre ans de services non interrompus dans ce département sur l’unique motif que la longueur de ces mêmes services le mettait dans le cas de jouir de la pension de retraite. Malgré toutes les démarches qu’il n’a eu cesse de faire depuis plus de deux ans, il n’a encore pu l’obtenir. Cependant il a été forcé de vendre successivement ses effets, afin de pourvoir à sa subsistance et à celle de sa famille jusqu’à présent; de sorte qu’il se trouve aujourd’hui dénué de toutes ressources et hors état de remplir les engagements qu’il a contractés avec ses gendres qui sont eux même dans le besoin.
Dans cette pénible situation il vous prie, Citoyens Directeurs d’engager le ministre des Relations extérieures à le rapeller à ses fonctions. Le zèle avec lequel il les a constamment remplies et la pureté de son patriotisme attestés par les différents chefs sous la direction desquels il a travaillé sont un sûr garant de celui qu’il continuera d’y apporter ainsi que de son attachement aux principes républicains.
D’après ce fidèle exposé de l’état désespéré d’un infortuné père de famille qui n’avait que sa place pour la faire vivre, il espère de votre justice et de votre humanité, Citoyens Directeurs que vous accueillerez la juste demande, surtout si vous voulez bien considérer qu’ayant servi pendant les tems les plus orageux de la révolution, il avait lieu de se flatter qu’à l’époque de sa réforme du Gouvernement [profitant?] d’une heureuse consistance, lui assurerait la stabilité de son poste que son âge et ses forces lui permettraient d’occuper pour encore longtemps.
J Goffinet »
Il accompagne son mémoire de recommandations, sans quoi il serait difficile d’obtenir quoique ce soit. Il en a au moins une de poids, avec celle de Charles Antoine Chasset :
« 14 Germinal an 6
Citoyen Ministre
Une connaissance que j’ai faite à Versailles dans le tems des Etats généraux, et dont j’étais le plus près voisin, a pensé que je pouvais la servir, en joignant ma prière à celle de Beaucoup d’autres pour une place qu’elle sollicite. C’est le citoyen Goffinet, ancien employé dans vos bureaux, dont la demande est ci-jointe. Je vous assure qu’il m’a inspiré le plus grand intérêt, par ses talents, ses services et la détresse où il se trouve ainsi que toute sa famille. Si ma faible voix peut vous inspirer un peu de cet intérêt, et qu’il vous soit possible d’accueillir sa demande vous lui rendrés la vie, et je vous en aurai une éternelle obligation.
Salut et respect
Chasset »
Son voisin pendant les états généraux est un révolutionnaire modéré, qui vota contre la mort du roi. Après avoir été président de l’assemblée nationale en 1790, puis conventionnel, il contribua à l’insurrection lyonnaise et se serait caché en Suisse et en Autriche pendant la terreur. Il redevint influent sous le Directoire et présida encore le Conseil des Cinq-Cents. Pendant une année, il fut chef de division au ministère de l’intérieur, avant d’être de nouveau élu au Conseil des Anciens, au sein duquel il prendra place quelques jours après l’écriture de ce billet. Au moment de sa rédaction, cette ancienne connaissance de Goffinet était donc également le supérieur de son gendre, Louis Grégoire Despréaux, au sein de la 1ere direction du ministère de l’intérieur chargée de la correspondance avec les administrations locales, du maintien du régime constitutionnel, etc…[118]
Goffinet réintègre donc le ministère peu après sa demande, et plus précisément la troisième division chargée de la correspondance avec l’Italie, les Deux-Siciles, l’Espagne, le Portugal, l’Angleterre et les États-Unis. Sa pension est enfin liquidée l’année suivante, par une loi du 7 germinal VI (27 mars 1799). Après un savant calcul (une proportion du traitement des 30 premières années, une autre des 14 années suivantes), le montant est fixé à 4534,67 francs. Il continue cependant à travailler, et cumule son traitement avec une partie de sa pension.
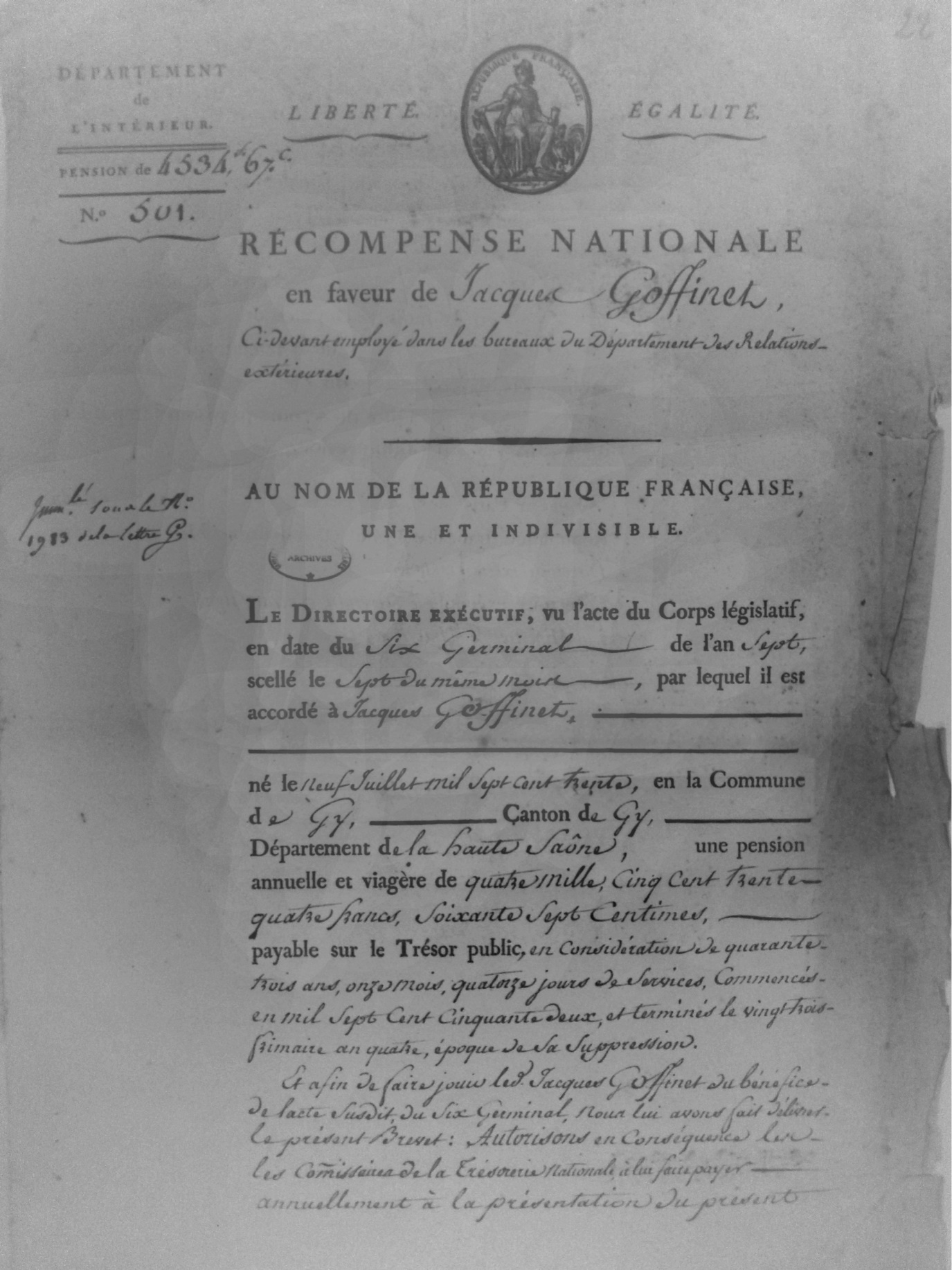
Récompense nationale (retraite) obtenue par Jacques Goffinet
A deux reprises, il demandera une augmentation:
« 6 fructidor an IX (24 octobre 1801)
Citoyen ministre
Il y a près de quatre ans que vous avez eu la bonté de rapeller le citoyen Goffinet aux Relations extérieures d’où il n’avait été réformé par Charles Delacroix au bout de quarante quatre ans de services non-interrompus en qualité de sous chef de division politique dans ce même département que parce que l’ancienneté de ses services le mettait dans le cas de jouir de la pension de retraite; comme il ne demande pas mieux que de travailler pour la gagner, il vous prie, citoyen ministre, de vouloir bien completter la justice que vous lui avez rendue, en rapprochant son traitement actuel de celui dont il jouissait avant sa réforme: ses besoins et ceux de sa nombreuse famille lui imposent la nécessité de réclamer votre bienveillance. Les honorables témoignages de sa conduite sont déposés à votre bureau des fonds; il se flatte que le citoyen Hauterive, dans la division duquel il est employé, voudra bien y joindre le sien.
Goffinet »
« L’augmentation de cinq cent francs que le ministre a accordé au citoyen Goffinet devient nulle pour lui en vertu de la loi qui autorise la Trésorerie nationale à completter jusqu’à la somme de mille écus le traitement des pensionnaires employés. Pour lui rendre cette augmentation profitable, il serait nécessaire que le ministre la portât sur tel autre état de dépenses qu’il jugerait convenable.
Si à cette modique augmentation de 500 francs le citoyen Talleyrand voulait bien y joindre celle de 500 autres, il comblerait les voeux du citoyen Goffinet et de sa famille. Son âge avancé et 46 ans de services dans le Département des relations extérieures lui inspirent la confiance que le citoyen ministre voudra bien prendre sa juste demande en considération.
Goffinet »
(non daté, probablement 1803)
Goffinet est revenu comme doyen des commis, raillés à l’époque:
« Il y avait autrefois trop de commis dans les bureaux, relativement à l’ouvrage; il y en a aujourd’hui trois fois davantage, et l’on pense qu’il n’y en a pas encore assez.
Voici le mot: le travail de bureau n’étant qu’une routine minutieuse, le plus ancien commis est toujours le plus instruit; d’où il suit que chaque fois que l’on déplace un ancien employé, (ce qui arrive assez souvent) on est obligé de le remplacer par deux ou trois autres.
Entrez dans une administration de détail; voyez-vous cette immense quantité de cartons? Chacun contient un grand nombre de pièces. Eh bien! Ce vieux commis qui sèche sur son fauteuil de maroquin, est le répertoire ambulant de ce volumineux recueil; renvoyez-le, vous aurez perdu la clef de fastidieux travail, et il faudra deux ans de constance et d’ennui pour le remplacer. »[119]
Le nombre de commis est en effet un sujet récurrent des railleries de la littérature satirique. Dans une brochure intitulée Changement de domicile[120], en même temps qu’il est prétendu que les conscrits ont été envoyés rue des boucheries et qu’on fustige les généraux « qui ont fait tomber sous les coups de l’ennemi cette intéressante jeunesse », on prétend que les employés ont été envoyés « rue des Jeuneurs: il y en a tant, et la République est tellement obérée qu’il lui est impossible de payer exactement l’armée de commis de toutes les couleurs qui rongent sa subsistance. »
Mais les commis ne sont pas en reste en matière de sarcasme. Un règlement sévère du Directoire est édicté le 5 vendémiaire an VII (27 septembre 1798): les employés ne recevront pour leur rétribution que leur traitement fixe. Il ne leur sera fourni que le papier, l’encre, le pulvérin, le pain et la cire à cacheter; le bois pour le chauffage sera réglé pour chacun d’eux et ne pourra être excédé. Les expéditionnaires devront donner au moins sept heures de travail tous les jours, et le travail aura lieu de neuf heures à quatre heures. La feuille de présence devra être signée au moins trois fois par jour. Les absents seront privés, la première fois, de dix jours de traitement; la seconde, d’un mois; ils seront révoqués à la troisième absence. L’état des employés sera remis au Directoire avec des notes des chefs de division, et l’on ne donnera d’avancement que sur ces notes. Tout cela suscite des réactions…
A cette époque, paraît une brochure intitulée « Ordonnance burlesque de la République iroquoise »[121], de toute évidence écrite par des commis des affaires étrangères. En voici quelques extraits:
« Le Gouvernoire de la République iroquoise, considérant qu’il existe dans ses bureaux:
De profonds jurisconsultes et de célèbres avocats
De savants en diplomatie, qui ont étudié longtemps et connaissent bien les constitutions, les forces et les ressources des différentes puissances avec lesquelles la République iroquoise est obligée d’entretenir des relations.
Des travailleurs zélés qui souvent se rendent dans leurs bureaux avant l’heure, et quelques fois n’en sortent qu’après;
Des employés, qui prenant goût à leurs occupations, outrepassent leurs devoirs, en emportant chez eux les dossiers des affaires importantes, pour les étudier à loisir, au lieu de se livrer aux jeux de hazard, aux dissipations, aux plaisirs… »
« Considérant que les savants, les artistes, les hommes d’honneur, ci dessus énumérés, forment les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des employés des dits bureaux, tandis que l’autre centième est composé de sujets plus ou moins inférieurs en talents, en vertus, en exactitude…
Considérant qu’un mauvais sujet, au milieu de quatre vingt dix neuf bons est trop facile à reconnaître et à punir, ce qui enlève à l’autorité suprême le plaisir de faire trembler indistinctement tous ses subordonnés
Considérant que remplir ses devoirs de bonne volonté… C’est se soustraire malicieusement aux réprimandes, et ôter au Gouvernoire les moyens de faire sentir sa puissance.. Si cet abus subsistait longtemps, on ne s’appercevrait plus des maîtres, les magistratures suprêmes ne seraient que des titres ad honores… des évêchés in partibus.
Considérant qu’il est intéressant pour la gloire de la République iroquoise, de n’avoir dans lesdits bureaux que des employés du même genre, pour ne pas laisser tomber en désuétude le grand principe d’égalité: qu’en morale comme en physique il est plus facile de descendre que de monter, c’est à dire pour parler sans figures, qu’il est plus facile de perdre de bonne qualité que d’en acquérir. »
« Considérant encore une foule de considérations, toutes plus considérables les unes que les autres;
tout considéré
Le Gouvernoire iroquois, de sa certaine science, pleine puissante et autorité gouvernante, ordonne ce qui suit: »
« Tous les employés, tant des bureaux du Gouvernoire et de ceux de ses ministres, que des autres administrations principales et secondaires, quels que soient leurs talents, leurs vertus et leurs âges, sont égaux aux yeux du Gouvernoire.
En conséquence, il est enjoint au septuagénaire et à l’invalide qui porte une jambe de bois, de courir aussi vite que le jeune imberbe de 15 à 18 ans, à peine pour le vieillard et l’invalide d’être traités comme des enfans , ou tout au moins, d’employer une heure de plus avant et après leur travail à parcourir le chemin de leur maison au bureau, pour les récompenser de leurs longs services. »
« Tous les employés auront un tempérament également robuste; ils ne seront pas plus savants les uns que les autres, de peur que la dangereuse aristocratie des talents ne s’introduise dans la parfaite République iroquoise. »
« Tous les employés entreront dans les bureaux et en sortiront en foule tumultueuse, afin qu’ils prennent la manière des écoliers, et qu’ils n’usurpent plus une seule parcelle du respect qui n’appartient qu’au Gouvernoire. »
« Ils signeront à la file une feuille de présence, à 9 et à 4 heures précises; et ladite feuille sera déposée dans l’antichambre et confiée aux garçons de bureaux, afin qu’ils aient l’air de commander à leur tour, et qu’ils cessent de croire que les employés sont au-dessus d’eux, en voyant qu’ils sont plus maltraités. »
« Chaque ministre aura une pendule infaillible; il l’avancera et la retardera, de manière à obtenir le plus possible d’amendes et de travail effectif. »
« Les ministres et les chefs des administrations changeront, au moins une fois par mois, l’organisation de leurs bureaux; ils auront attention de transporter souvent les commis d’un bureau dans un autre, de donner le commencement d’une affaire à traiter à celui-ci, et la fin à celui-là. Par cette sage mesure, lesdits ministres et chefs connaîtront seuls l’ensemble de leurs machines; seuls ils tiendront, les fils des affaires; conséquemment ils garderont seuls les secrets de l’état, derouteront la curiosité de leurs subordonnés, et parviendront à paraître plus savants que les anciens employés, et à les empêcher de se prévaloir d’une expérience insubordonnée »
« Tout homme nouvellement appellé à un ministériat ou à un poste de chef d’administration, débutera par une organisation des bureaux, laquelle sera la meilleure de toutes celles ordonnées par l’article précédent parce qu’il ne connaîtra ni les personnes ni les choses. A cette première, il réformera quelques employés, sous prétexte d’économie à la seconde, il placera quelques-unes de ses créatures, sous prétexte de nouveaux besoins; à la troisième, il opérera des réformes; à la quatrième, il pourvoira des amis, ainsi de suite alternativement, jusqu’à ce qu’il ait acquis dans les bureaux une belle majorité, composée de ses amis, et des amis de ses amis. Alors il sera lui-même culbuté, de peur qu’il ne parvienne à connoître trop bien l’ensemble de sa machine, à se faire un parti et à porter ombrage au Gouvernoire. »
« Donné à Laboue, au Palais gouvernorial, le premier jour du mois des ivrognes, l’an trente millième de la République iroquoise, et le premier de la pacification universelle.
Signé, MAGISTER, président
le Gouvernoire
Signé, IGNORANTIN, Secrétaire d’Etat,
ayant le département des sciences et des arts »
Peut-être la brochure date-t-elle de l’époque de Delacroix, mais elle est assez intemporelle. Talleyrand a dû en sourire, lui qui ne faisait que suivre et exécuter les ordres de la « nouvelle aristocratie » du Directoire qu’il sert tout en s’en démarquant[122].
Dans les années suivantes, une partie du monde de l’ancien régime revient: Hauterive, chef de la deuxième division, et Talleyrand se sont fréquentés dans leurs jeunesses au château de Chanteloup, résidence du duc de Choiseul. Des fêtes sont organisées dans les locaux du ministère (en l’honneur de Bonaparte ou de Joséphine), dont beaucoup d’invités reviennent d’émigration. Les usages changent: la formule « Salut et fraternité » est remplacée par « Je vous salue » en 1801, puis par « J’ai l’honneur de vous saluer » en 1803.[123] Le tutoiement et l’appellation « citoyen » disparaissent.
Après tous les changements intervenus pendant la révolution, ils sont trois de l’ancienne division de Gérard de Rayneval à être employés sous Talleyrand. Goffinet est le doyen des commis. Les deux autres, Gambier-Campy et Cornillot, arrivés dans les années 1770, sont employés au sein du bureau du chiffre, qui a été recréé.
Talleyrand se retira prudemment le 20 juillet 1799 pour préparer le coup d’Etat de Bonaparte et Sieyès. Un ministre moins politique, ancien du ministère, Reinhard, le remplaça. Le lendemain du coup d’Etat, Reinhard fut renommé ministre par les consuls, le 19 brumaire, et prêta, avec tous ses employés, le serment d’être fidèle à la République une et indivisible, fondée sur la liberté, l’égalité et le système représentatif. Une fois le Consulat installé, Talleyrand revint au ministère le 1er frimaire an VIII (21 novembre 1799).
Pendant son court ministère, Reinhard fit d’importantes réformes. On revint au système des deux divisions politiques : celle du Nord, et celle du Midi, dans laquelle travaille Goffinet. De nombreux commis incompétents ou trop impliqués politiquement furent réformés. Le nombre de commis de l’administration centrale du ministère se stabilisa ensuite à une cinquantaine pendant le Consulat et l’Empire.
La rémunération de Goffinet progressera et s’élèvera jusqu’à 6300 francs en 1813[124]. Si la situation de Goffinet comme généralement celle des commis s’améliore, elle est plus liée aux conditions générales, stabilité politique et redressement budgétaire, qu’à des dispositions spécifiques. De plus, comme sous l’ancien régime, un fossé social et pécuniaire sépare les commis médiocrement rémunérés et les emplois supérieurs des intimes du pouvoir[125].
Les crédits du ministère augmentent très sensiblement sous le Consulat puis sous l’Empire. Lorsque Champagny remplace Talleyrand en 1807, Napoléon lui écrit: « Mon intention est que mon ministre des Relations extérieures ait plus de livrées, plus de luxe, plus de gens et de représentation que le ministre de l’intérieur »[126]. Le traitement du ministre et ses frais de maisons deviennent supérieurs à l’ensemble des traitements du personnel du ministère.
Le ministère a peu d’autonomie par rapport à l’empereur. Napoléon s’informe beaucoup mais consulte peu, ce n’est pas sans conséquence sur l’activité du ministère. Talleyrand suit parfois, de loin, l’armée dans ses campagnes, et doit rester de longs mois en Italie, en Allemagne et en Pologne. Il emmène avec lui quelques commis, mais probablement pas Goffinet[127].
L’activité documentaire sert parfois à constituer des documents de propagande. En 1809, Napoléon envahit les états pontificaux. En vue de justifier l’annexion, il demande au ministère une étude historique des rapports entre la France et le Saint-Siège depuis les carolingiens[128]. Tous les commis y travaillent pendant 16 jours et la synthèse de leurs travaux sert à justifier la politique napoléonienne.
Fin de vie
Jacques Goffinet fit profiter ses petits-fils de sa place. Ce courrier (non daté mais sûrement écrit pendant le Consulat) a été conservé dans son dossier:
« Citoyen ministre,
Je réclame votre bienveillance en faveur de mon petits fils qui suit depuis plusieurs années, par autorisation du ministre de l’intérieur, le cours d’étude du Prytanée[129]. Je désirerais que vous voulussiez bien l’admettre en qualité de surnuméraire aux jeunes de langue. Cet enfant annonce d’heureuses dispositions. Son père est employé depuis plus de vingt ans dans les bureaux du ministère de l’intérieur, et n’a pour pouvoir à l’existence et à l’éducation de quatre enfants que les faibles émoluments de sa place. J’espère, citoyen ministre, que ces motifs intéresseront assez vos sentiments de bonté et d’humanité pour vous porter à m’accorder la faveur que je vous demande; je la recevrai comme une récompense de mes longs services dans votre département.
Goffinet Employé à la 2 division »
Les usages ont changé en 1810 lorsqu’il s’agit de positionner le cadet: le courrier est adressé cette fois à « A son excellence, Monseigneur le duc de Cadore, ministre des relations extérieures ». Il reçoit cette réponse:
« Paris le 24 août 1810
Vous m’exposez, M., que le jeune de langue Félix Despréaux St Sauveur votre petit-fils ayant terminé son cours d’étude doit être envoyé incessamment à Constantinople et vous me témoignez le désir de le voir remplacé par son frère cadet.
C’est une demande à laquelle j’accède d’autant plus volontiers qu’elle me fournit l’occasion de vous prouver le cas que je fais de vos longs et utiles services et d’en faire rejaillir le mérite sur vos enfants. J’ay en conséquence ordonné que votre second petit fils fut inscrit sur la liste de la candidature et dès qu’il aura atteint l’âge prescrit par les règlements il sera admis à l’école des langues orientales établis à Paris, s’il y a des vacances. Agréez, M., l’assurance de ma parfaite considération. »
Le destin des petits-enfants est programmé. Le cadet, Fulgence Napoléon Despréaux de Saint Sauveur, mourra jeune, mais l’aîné, Félix Despréaux de Saint Sauveur, fera une belle carrière au sein du personnel diplomatique en Orient. Il sera consul à Odessa, Corfou et Alep.
Jacques Goffinet meurt le 23 mars 1813, âgé de 82 ans. Il était encore employé à la direction du Midi avant la mise en œuvre d’une énième réforme consistant à rediviser les divisions du Nord et du Midi et créer des bureaux Ouest et Est. L’usage sous l’Empire était que les employés étaient payés chaque mois. Un des commis ou le chef allait chercher la somme des traitements du mois des employés de sa division auprès du payeur du trésor puis remettait son traitement à chacun de ses collègues. On trouve fréquemment la signature de Goffinet sur les états. C’est donc souvent lui qui se chargeait de cette tâche.
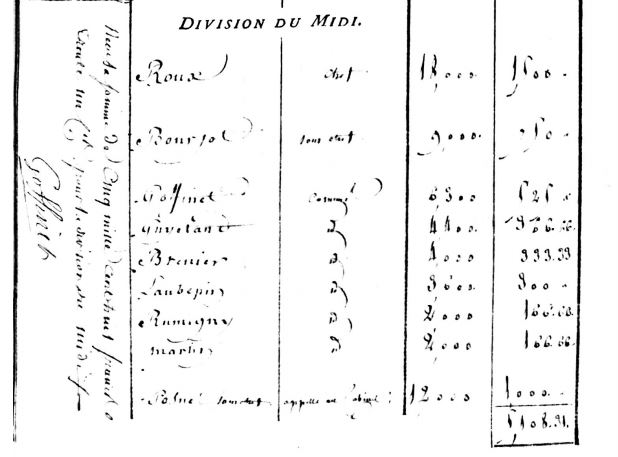
Reçu signé par Goffinet en septembre 1810
Il aurait eu 61 ans de services, entre 1752 et 1813, interrompus par sa suspension de l’année 1768 et celle de 2 ans environ entre décembre 1795 et avril 1798.
Les traités d’alliance avec l’Autriche de 1756 étaient très mal vus par beaucoup de dirigeants révolutionnaires. C’est peut-être pour cela que dans son dossier la date de début de 1756 est parfois utilisée. Les comparaisons d’écriture semblent indiquer que la date à retenir est bien 1752. Goffinet a dû occuper un poste subalterne à l’ambassade d’Autriche, et sous la révolution, il ne s’est pas vanté de s’être trouvé à Vienne pendant les pourparlers des traités d’alliance même s’il n’y a sûrement joué aucun rôle. Au moment de la liquidation de sa pension, il a fait corriger la date.
De toute évidence, il aurait pu continuer sous la restauration, il n’y eut pas de grandes épurations au ministère sous Louis XVIII.
Il travaille jusqu’à un âge avancé, avec peut être des prédispositions à la bonne santé qu’il transmit à sa fille aînée Thérèse-Sophie et à son petit-fils Jacques Amable Regnault, archiviste au Conseil d’Etat, qui moururent tous deux à 98 ans.
Il laisse 14.000 francs d’héritage à ses deux filles, preuve qu’il était revenu à meilleure fortune, même si cela semble peu pour quelqu’un qui touchait 6000 livres par an dans les années 1780 et plus de 6000 francs dans les années 1810. C’est tout de même ce que gagnait un travailleur non qualifié en toute une vie. Son beau-père Joubain avait laissé sensiblement la même chose: 14075 livres 6 sols et 9 deniers[130]
On trouve à la fin du dossier de Jacques Goffinet aux archives du Ministère des affaires étrangères, ce projet de lettre de sa fille Marie Félicité, assez maladroit:
« Projet d’une pétition à donner à Monseigneur le Prince de Bénévent, Ministre des affaires étrangères
Monseigneur,
C’est comme fille de M. Goffinet, que j’ai l’honneur de réclamer votre bienveillance, il était le doyen des employés du ministère des affaires étrangères par 65 ans de services, lorsque j’eus le malheur de le perdre. Mon père a éprouvé de grandes infortunes par suite de la révolution; elles ont rejailli sur moi de telle manière que j’en suis réduite à la plus grande détresse. Permettez, monseigneur de vous en présenter le précis.
1° il a eu le malheur de voir réduire à nulle valeur une maison à Versailles qu’il avait reçue de son épouse, avant la translation des Bureaux du ministère à Paris.
2° il a été remboursé avec des assignats sans valeur de 15000 qui lui était due.
3° il a été privé de son emploi par Charles Delacroix, ministre, au fort de la tempête révolutionnaire, sous le prétexte de son opinion royaliste; il est vrai que l’attachement de mon père à l’ancienne famille de nos rois a toujours été inaltérable; et c’est à votre âme sensible et conscient des injustices qu’il a dû d’être rappelé au ministère, après 4 ans qu’il en était sorti. mais la gène qui existait dans les finances de l’Etat ne vous permit d’accorder à mon père, pour traitement, que 2400 F au lieu des 7000 l dont il avait toujours joui à Versailles et à Paris à titre de principal commis ou de sous-chef.
Mon pauvre père, en passant par une telle filière de circonstances malheureuses n’a pu subsister qu’à l’aide d’emprunts extrêmement onéreux, et s’est trouvé dans l’impossibilité de remplir ses engagements qu’il regardait comme les plus sacrés tels par exemple, que ceux qu’il avait pris, en me mariant, de payer annuellement à mon mari une rente de 1000 l à titre de dot.
Je suis donc restée à la merci de mon époux qui a épuisé toutes ses ressources en me faisant subsister avec ses enfants; à la mort de mon père votre prédécesseur ne fut pas plutôt informé de la nouvelle gène de ma mère qu’il s’empressa de lui accorder une pension de 1500 F dont elle n’a joui que cinq mois, n’ayant survécu à son mari que pendant un court intervalle de temps à raison de sa douleur de l’avoir perdu. Sa tendresse maternelle lui avait toujours fait partager cette pension avec moi ainsi qu’elle l’a fait pendant le peu de temps qu’elle l’a touchée.
Je vous supplie, monseigneur, d’après la série de malheurs qui ont été le cruel partage de mes parents, et dont l’effet m’a si fortement frappée, de vouloir bien faire rétablir en ma faveur la pension qui avait été accordée à ma mère, ou de vouloir bien accorder un emploi équivalent à mon mari dans la division des archives de votre ministère. Comme il a été attaché au bureau des affaires étrangères pendant tous les jours le ministère de M. de Vergennes avec son oncle M. Pétigny de St Germain qui a été collègue de MM. de Rayneval et Henin, vous pourrez penser que cette circonstance lui donne quelques titres dans le cas d’être [réemployé?] aux mieux et d’intéresser d’autant plus votre cœur généreux, et j’ose en concevoir l’heureuse espérance
je vous prie, Monseigneur de vouloir bien agréer à l’avance la vive et inaltérable reconnaissance d’une famille pour tout ce que vous voudrez bien avoir la bonté de faire pour elle. »
La lettre a surement été écrite pendant l’année 1814, pendant la première Restauration. « Prince de Bénévent », est le titre de Talleyrand lui-même sous l’empire à partir de 1806. Bénévent est un état confisqué au Pape dans lequel il ne se rendit pas et se contenta d’envoyer un gouverneur. Dès lors, il peut sembler étrange que l’éloge des Bourbons coïncide avec l’appellation de « prince de Bénévent ». La lettre a dû être rédigée dans l’intervalle de temps entre la nomination de Talleyrand aux affaires étrangères et la réception de son nouveau titre donné par Louis XVIII: « prince de Talleyrand » (en décembre 1814). Talleyrand contribue en effet largement à mettre Louis XVIII sur le trône et devient ministre pendant la première Restauration à partir du 13 mai 1814. Bénévent est rendu au pape. Talleyrand négocie lui-même la rétrocession et obtient une confortable indemnité. Chateaubriand prétendra qu’il « vendait sa livrée en quittant son maître. »[131]
Il est piquant que cette lettre demandant récompense d’un attachement « inaltérable » aux Bourbons soit adressée à Talleyrand. Autrefois l’ancien évêque amenait son fils Charles de Flahaut à la fête du 21 janvier célébrant la mort de Louis XVI, notamment aux courses de chevaux du champ de mars pour « l’anniversaire de la juste punition du dernier roi des Français »[132]. Il aurait dit lors du serment qu’il fit à Louis-Philippe en 1830 (il fut alors nommé ambassadeur à Londres), qu’il s’agissait de son treizième serment[133]. Ces inconstances étaient dénoncées dès cette époque. Talleyrand figure en bonne place dans un dictionnaire des girouettes[134] qui parait en 1815, avec quelques autres chefs de Goffinet (Colchen, Roux, Hauterive).
En parlant d’opinion royaliste, soit Marie-Félicité Goffinet tente de jouer la même comédie que le ministre (forcément avec moins de talent) soit elle était peu au fait de la politique. Sans insister, on peut tout de même rappeler un des prénoms de son fils cadet: « Napoléon ». On l’a dit, il y avait une différence sociale, culturelle et pécuniaire entre commis et dirigeants de l’état. Il existait aussi une frontière entre politique et administratif, même si elle était floue et changeante. Ce n’est donc pas la même chose pour le prince de Talleyrand et pour Jacques Goffinet que de travailler pour plusieurs régimes successifs, même s’ils ont tous deux, après tout, continué à faire ce qu’ils savaient faire avec des maîtres différents.
Quelles ont pu être les opinions politiques de Goffinet ? Sa longévité incite à penser qu’il n’était pas un exalté. Sa proximité avec Rochon sous l’ancien régime ou avec Chasset sous la Révolution permet de plaider pour des opinions issues des lumières modérées. On peut lui prêter les opinions assez communes dans sa classe sociale.
A-t-il eu recours à des accommodements mesquins pour conserver sa place ? Ce serait juger ainsi la discrétion qui était l’usage chez les commis sous l’ancien régime et dont il avait fait preuve pendant 40 ans (1752 à 1792) avant la fin de la monarchie. Cela l’avait sans doute préparé à passer au travers des purges. On peut distinguer temps long de l’institution et soubresauts politiques. Il a bénéficié d’augmentations fréquentes et de gratifications qui permettent de supposer que ces supérieurs étaient contents de son travail. Peut-être est-il possible de voir en lui le vieux commis « répertoire ambulant de ce volumineux recueil » de la satire que l’on a cité. Sans doute avait-il des compétences, et il était probablement dans l’intérêt du bureau de l’employer, quel que soit le régime. Pour ce qui est de son intérêt à lui, sa situation matérielle ne lui permettait pas de changer d’employeur. Les missions en Autriche et en Pologne n’ont pas engendré une spécialisation dans les matières de ces deux pays puisque Goffinet fit ensuite sa carrière dans le bureau du midi. On peut plutôt supposer une spécialité, s’il en a eu une, dans le chiffrement et dans ce qui touche à l’Espagne, l’Italie et la Suisse.
Il ne s’agit que d’un projet de pétition de la part de Marie Félicité… Pour expliquer le fait de retrouver ce projet dans le dossier de Goffinet aux archives diplomatiques, on peut faire l’hypothèse qu’elle ait présenté le projet à d’anciens collègues de son père qui ont pu l’amender.
Une lettre presque identique fut ensuite envoyée au duc de Richelieu (ministre des affaires étrangères et principal ministre à partir de septembre 1815). Elle ne contient pas la phrase « sous le prétexte de son opinion royaliste… », et la demande est maintenant que le petit-fils Félix reste à Paris: « Je vous supplie, Monseigneur, de vouloir bien fixer dans les bureaux du ministère, mon fils qui après avoir passé six ans dans le Levant, a été autorisé par votre excellence à revenir en France à cause du mauvais état de sa santé, altérée par les fatigues du voyage au point qu’il ne pourrait sans danger en entreprendre de nouveaux, aux titres que lui donnent les 65 années de services de son grand-père qui est mort dans la pensée qu’il aurait un jour en lui un représentant dans le ministère. »
Félicité Goffinet n’obtiendra pas de pension. Son mari, Louis-Grégoire Despréaux de Saint Sauveur, quitta le ministère des finances et toucha une pension de retraite à partir de cette même année 1814. Le dénuement de la famille n’était pas feint. Marie Félicité Goffinet mourut en 1819 et Louis Grégoire Despréaux de Saint Sauveur en 1824 en ne laissant presque aucun héritage à leurs enfants. Mais on l’a dit, le principal héritage pour le petit-fils Félix Despréaux de Saint Sauveur fut la place que lui obtint son grand-père alors qu’au XIXe siècle, avoir des recommandations solides et de la famille dans le ministère constitue un critère de recrutement essentiel. À son retour du Levant, Félix fit une demande de poste au ministère au comte de Rayneval, fils de Gérard de Rayneval, le chef de son grand-père, qui devint sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères en 1820. On le lui accordera, et il obtiendra ensuite de continuer sa carrière dans les consulats d’Orient. Il sera le premier d’une lignée de diplomates.
Sources
Archives diplomatiques:
Comptabilité ancienne 1661-1911 vol 18, vol 20
266QO Personnel, Première série nominative vol 35 (Goffinet), 39 (Joubain)
ACQ2000, volumes 150 à 153
Pologne, vol 274 et ss
Autriche, vol 251, et ss
Archives nationales:
AN ET-XXVII-329 1766
AN, O/1/113
AD78 :
3E44 175 Minutes Gilles Barat Ricqbourg, 1783, janvier -juin
Cahier doléances Versailles: AD 78, 1789 13B 13 [19]
Sources imprimées (pour la plupart disponibles sur Gallica):
Règlement (du Secrétaire d’Etat de la guerre) que le Roi veut être observé dans les hôtels situés à Versailles où sont établis les bureaux de la guerre et de la marine, et le dépôt des affaires étrangères, impri. Royale, 1765
État Nominatif Des Pensions Sur Le Trésor Royal, Volume 2, imprim. nationale, 1790
État nominatif des pensions, traitemens conservés, dons, gratifications, qui se payent sur d’autres caisses que celle du trésor royal, Imprimerie Nationale, 1790
Almanach royal, diverses années
Almanach national, diverses années
Broglie, Charles François, Correspondance secrète inédite de Louis XV sur la politique étrangère avec le comte de Broglie, Tercier, etc., et autres documents, Plon, 1866 (réédition 1956 Ozanam, Antoine)
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France : depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française. IV-V, Pologne. T. II. 1729-1794, 1888
Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France : depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française. I, Autriche, Commission des archives diplomatiques, 1884
Rochon de Chabannes, La noblesse oisive, s. n., 1756
Miot, André François, Mémoires du comte Miot de Mélito, Michel-Lévy frères, 1858
La France littéraire, veuve duchesne, 1769
Bailly Jean Sylvain, Mémoires d’un témoin de la Révolution, Levrault, 1804
1789-1889. Centenaire. Bailliages de Versailles et de Meudon. Les cahiers des paroisses, avec commentaires, Aubert, 1889, p. 211
Bonnecarrère, Guillaume, Exposé de la conduite de Guillaume Bonnecarrère depuis le commencement de la Révolution jusqu’à ce jour, Vatar, 1793
Pujoulx Jean-Baptiste, Paris à la fin du XVIIIe siècle, Mathé, an IX – 1801
Doniol Henri, Le cte de Vergennes et P.-M.Hennin 1749-1787, Armand Colin, 1898
Durency, Changement de domicile, de l’impr. de l’auteur, sans date
Ordonnance burlesque du gouvernoire de la République iroquoise, traduite en français par Dulys, grammairien, Rue de la Liberté, N.° 36, s. N., s.d.
Eymery Alexis, Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d’après eux-mêmes, JB Imbert, 1815
Journal et Memoires du Marquis d’Argenson. Par E.J.B. Rathery. Paris, 1864
Théâtre du XVIIIe siècle, II, Édition de Jacques Truchet, Pléiade, Galimard, 1974
Duveyrier Honoré, Anecdotes historiques, Alphonse Picard, 1907
Barère Bertrand, Mémoires, Meline, 1842
Recueil des actes du Comité de salut public, Tomes 12 et 14, PUF, 1951
Lamare, Le républicain français, 10 avril 96
Chateaubriand François-René de, Mémoires d’outre-tombe, I et II, Pléiade, Gallimard, 1950
Thuillier Guy, Témoins de l’administration, Berger Levrault, 1967
Young, Arthur, Voyages en France, Tallandier, 2009
Bibliographie
Ouvrages de références:
Samoyault Jean-Pierre, Les bureaux du Secrétariat d’État des Affaires étrangères sous Louis XV, Éditions A. Pedone, 1971
Baillou Jean et al., Les affaires étrangères et le corps diplomatique français, édition CNRS, 1984
Maral Alexandre, Les derniers jours de Versailles, Perrin, 2018
Autres ouvrages et articles:
Aubaret Claire, « Les copistes du Cabinet des tableaux de la surintendance des Bâtiments du roi au xviiie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études
Bardoux A., Pauline de Montmorin, comtesse de Beaumont, Revue des Deux Mondes, tome 58, 1883, pp. 273-300
Bas Andrée. La voirie de Paris autrefois. In: L’information géographique, volume 15, n°1, 1951. pp. 14-18
Bély Lucien, Le secret du roi, revue des deux mondes, avril 2016
Bély Lucien, Les relations internationales en Europe: XVIIe-XVIIIe siècles, PUF, 1992
Bienaymé Gustave, Le coût de la vie à Paris à diverses époques. Moyens de transport publics, Journal de la société statistique de Paris, tome 42 (1901), p. 293-310
Blanc Olivier, Les hommes de Londres, histoire secrète de la terreur, Albin Michel, 1989
Bled, Jean Paul, Histoire de Vienne, Fayard, 1998
Bruley Yves, « The Napoleonic diplomatic corps », Napoleonica. La Revue, 2009/1 (N° 4), p. 30-49
Cerf Madeleine, La Censure Royale à la fin du dix-huitième siècle, Communications, 9, 1967
Conchon Anne, Paris et les transports sous la Révolution In : À Paris sous la Révolution : Nouvelles approches de la ville [en ligne]. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2008
Cottret Monique, Choiseul, l’obsession du pouvoir, Tallandier, 2018
Dassé (Abbé), Chaville historique, 1897
Destrain Gaston, « Coqueret, peintre du Roy, officier municipal (1735-1807) », Revue de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, no 1, janvier-mars 1937, p. 1-18.
Exbalin Arnaud, Paris sans voiture, on en rêvait déjà en 1790, The conversation, 13 septembre 2018
Graeber David, Bullshit Jobs, Les Liens qui Libèrent, 2018
Istria Simon, La vie de Philibert Buchot, La Révolution française : revue historique, Charavay frères, janvier-juillet 1913, Tome 64, p. 311-326
Kawa, Catherine. Les ronds-de-cuir en Révolution: les employés du ministère de l’Intérieur sous la première République : 1792-1800, Éd. du CTHS, 1996
Kawa Catherine, Dictionnaire biographique des employés du ministère de l’intérieur de la première république, annexe de l’ouvrage Les ronds-de-cuir en Révolution
Laurent-Hanin, Histoire municipale de Versailles : politique, administration, finances (1787-1799), Cerf et fils, 1885
Lefort J., «L’enseignement du droit à l’ancienne Université de Strasbourg», RGDLJ, 1894, p. 385-403
Lentz Thierry, Les relations franco-espagnoles. Réflexions sur l’avant-guerre (1789-1808), Revue du Souvenir Napoléonien, 399, 1995
Levi-Bruhl Henri, La noblesse de France et le commerce à la fin de l’ancien régime, Revue d’histoire moderne, 1933-01, p. 221
Masson Frédéric, Le département des affaires étrangères pendant la révolution 1787-1804, Plon, 1877
Monnier François, Le Secret du roi ou l’histoire d’une sottise, La Revue administrative, 56e Année, No. 333 (Mai 2003), pp. 235-240
Montbas Hugues de, « Robespierre et les Bonaparte vus par le comte Colchen », Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1952, p. 336
Newton William Ritchey. Derrière la façade. Perrin, 2008
Olivares-Iribarren Itamar, L’affaire de Nootka-Sound (1789-1790). In: Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 28-2, 1992. Epoque moderne. pp. 123-148
Outrey Amédée, Histoire et principes de l’administration française des Affaires Etrangères (I), Revue française de science politique, 3ᵉ année, n°2, 1953. pp. 298-318
Perrault, Gilles. Le Secret du Roi. [1 La passion polonaise], Fayard, 1992
Perrault, Gilles. Le Secret du Roi. [2 L’ombre de la Bastille], Fayard, 1993
Piccioni Camille, Les premiers commis des affaires étrangères au XVIIe et au XVIIIe siècle, Boccard, 1928
Pinet Marcel, dir., Histoire de la fonction publique en France, T.2, Du XVIe au XVIIIe siècle / Jean Imbert…, Jean Nagle…, Jean Meyer… [et al.], Nouvelle Librairie de France, 1993
Platelle Fanny, Les Français, la langue et le théâtre français à Vienne aux XVIIIe et XIXe siècles et leur représentation dans le théâtre populaire viennois. 2012,. hal-00987878
Pradal Diane, La vie à Versailles au XVIIIème siècle. Journal d’une famille bourgeoise, L’harmattan, 2014
Roche Daniel, Histoire des choses banales: naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIIe-XIXe siècle), Fayard, 1997
Waquet Dominique, « Costumes et vêtements sous le Directoire : signes politiques ou effets de mode ? », Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 129, 2015, 19-54
Waresquiel, Emmanuel de, Talleyrand : le prince immobile, Fayard, 2003
- Lefort J., «L’enseignement du droit à l’ancienne Université de Strasbourg», RGDLJ, 1894, p. 385-403 ↑
- Bled, Jean Paul, Histoire de Vienne, Fayard, 1998, p. 76 et ss. ↑
- Platelle Fanny, Les Français, la langue et le théâtre français à Vienne aux XVIIIe et XIXe siècles et leur représentation dans le théâtre populaire viennois. 2012,. hal-00987878 ↑
- Cottret Monique, Choiseul, l’obsession du pouvoir, Tallandier, 2018, p. 95 ↑
- Bély Lucien, Les relations internationales en Europe: XVIIe-XVIIIe siècles, 1re éd, PUF, 1992, p. 585 ↑
- Pinet Marcel, dir., Histoire de la fonction publique en France, II, Nouvelle Librairie de France, 1993, p. 326 ↑
- Pinet, p. 333 ↑
- Baillou Jean et al., Les affaires étrangères et le corps diplomatique français, édition CNRS, 1984, p. 130 ↑
- Doniol Henri, Le cte de Vergennes et P.-M.Hennin 1749-1787, Armand Colin, 1898, p. 56 ↑
- Samoyault Jean-Pierre, Les bureaux du Secrétariat d’État des Affaires étrangères sous Louis XV, Éditions A. Pedone, 1971, p. 217 et passim. ↑
- Baillou, p. 136 ↑
- Il s’agit bien sûr du repas de mi-journée ! ↑
- Mémoire sur la manière dont le département des Affaires étrangères est réglé en France in Doniol, p. 49 ↑
- Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France : depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française. I, Autriche, Commission des archives diplomatiques, 1884, p. 327 ↑
- Perrault Gilles, Le Secret du Roi. [1 La passion polonaise], Fayard, 1992, p. 243 ↑
- Perrault, p. 242 ↑
- Samoyault, p. 71 ↑
- Cité dans Raxis Alexis de, Histoire générale et raisonnée de la diplomatie française, 7, 1811, p. 149 ↑
- Samoyault, p. 70 ↑
- Honoré Duveyrier, Anecdotes historiques, Alphonse Picard, 1907, p. 33 ↑
- Journal et Memoires du Marquis d’Argenson, E.J.B. Rathery, 1864, p. 190 [232] ↑
- Samoyault, p. 66 ↑
- Piccioni, p. 88 et Samoyault, passim ↑
- Almanach royal, 1786, p. 249 ↑
- In Piccioni, p. 261 ↑
- Samoyault, p. 316 ↑
- Les affaires, p. 137 ↑
- Samoyault, p. 181 ↑
- État nominatif des pensions, traitemens conservés, dons, gratifications, qui se payent sur d’autres caisses que celle du trésor royal, Imprimerie Nationale, 1790, p. 25 ↑
- Graeber David, Bullshit Jobs, Les Liens qui Libèrent, 2018 ↑
- Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France : depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française. IV-V, Pologne. T. II. 1729-1794, Commission des archives diplomatiques, 1888, p. 238 ↑
- Perrault, passim ↑
- Recueil Pologne, p. 241 ↑
- idem ↑
- Perrault, p. 83 ↑
- Correspondance secrète inédite de Louis XV sur la politique étrangère avec le comte de Broglie, Tercier, etc., Plon, 1866, p. 306 ↑
- Perrault, p. 83 ↑
- A. diplo, Acquisitions exc., vol. 190 ↑
- Correspondance secrète, p. 313 ↑
- Perrault, passim ↑
- Correspondance secrète, p. 137 ↑
- AN, MC-ET-VI-768, 30 décembre 1766 ↑
- Dossier Joubain aux archives diplo. 266QO vol39, et Samoyault, p. 152 ↑
- Samoyault, p. 141 ↑
- Dassé (Abbé), Chaville historique, 1897 ↑
- Le paysage autour de ce modeste terrain de Chaville a considérablement changé. Fameux au XIXe siècle pour ces blanchisseries, Doisu a aujourd’hui de très grandes tours et une mosquée. ↑
- État Nominatif Des Pensions Sur Le Trésor Royal, Volume 2, imprim. royale, 1790, pp. 258 et 338 ↑
- Claire Aubaret, « Les copistes du Cabinet des tableaux de la surintendance des Bâtiments du roi au xviiie siècle », Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles [En ligne], Articles et études, mis en ligne le 18 décembre 2013 ↑
- Destrain Gaston, « Coqueret, peintre du Roy, officier municipal (1735-1807) », Revue de l’histoire de Versailles et de Seine-et-Oise, no 1, janvier-mars 1937, p. 1-18 ↑
- Samoyault n’en compte que deux pendant tout le règne de Louis XV. ↑
- Théâtre du XVIIIe siècle, II, Édition de Jacques Truchet, Pléiade, Gallimard, 1974 ↑
- Cité par Henri Levi-Bruhl, La noblesse de France et le commerce à la fin de l’ancien régime, Revue d’histoire moderne, 1933-01, p. 221 ↑
- idem ↑
- La noblesse oisive, de l’imprimerie de la Noblesse commerçante (sic), Paris, 1756 (sans nom d’auteur) ↑
- AD78, baptêmes Versailles St Louis ↑
- Comme les personnages de Pradal Diane, La vie à Versailles au XVIIIème siècle. Journal d’une famille bourgeoise, L’harmattan, 2014 ↑
- AD92 E_NUM_CHA_BMS_7 1760-1769 ↑
- Almanach royal, 1769, p. 419 ↑
- Cerf Madeleine. La Censure Royale à la fin du dix-huitième siècle. In: Communications, 9, 1967 ↑
- La France littéraire, veuve duchesne, 1769 ↑
- AN ET-XXVII-329 1766 ↑
- Relevés du Cercle Généalogique de Versailles et des Yvelines ↑
- Il s’agit de carreau d’arbalète ↑
- Newton William Ritchey, Derrière la façade. Perrin, 2008, p. 196 ↑
- idem, p. 199 ↑
- Miot, André François, Mémoires du comte Miot de Mélito, Michel-Lévy frères, 1858, p. 10 ↑
- 1789-1889. Centenaire. Bailliages de Versailles et de Meudon. Les cahiers des paroisses, E. Aubert, 1889. Bien que le prénom diffère dans le texte, ce Lecointre est probablement celui qui dirigea la garde nationale de Versailles et devint conventionnel. ↑
- A. Bardoux, Pauline de Montmorin, comtesse de Beaumont, Revue des Deux Mondes, tome 58, 1883, pp. 273-300 ↑
- Maral Alexandre, Les derniers jours de Versailles, Perrin, 2018, p. 337 ↑
- Bailly Jean Sylvain, Mémoires d’un témoin de la Révolution, Levrault, 1804, p. 245 ↑
- Maral, p. 339 ↑
- Maral, p. 340 ↑
- Maral, p. 442 ↑
- Maral, p. 484 ↑
- Masson Frédéric, Le département des affaires étrangères pendant la révolution 1787-1804, Plon, 1877, p. 69 ↑
- Roche, Daniel, Histoire des choses banales: naissance de la consommation dans les sociétés traditionnelles (XVIIe-XIXe siècle), Fayard, 1997, p 118 ↑
- Olivares-Iribarren Itamar, L’affaire de Nootka-Sound (1789-1790). In: Mélanges de la Casa de Velázquez, tome 28-2, 1992. Epoque moderne. pp. 123-148 ↑
- AN, O/1/113 ↑
- Timothy Tackett, Le roi s’enfuit, La découverte, 2004 ↑
- Masson, p. 85 ↑
- Baillou, p. 332 ↑
- Masson, p. 150 ↑
- Exposé de la conduite de Guillaume Bonnecarrère depuis le commencement de la Révolution jusqu’à ce jour, Vatar, 1792, p. 12 ↑
- D’après Masson, s’il s’agit bien du même Mendouze ↑
- Baillou, p. 340 ↑
- Exbalin Arnaud, Paris sans voiture, on en rêvait déjà en 1790, in The conversation, 13 septembre 2018 ↑
- Bas Andrée, La voirie de Paris autrefois, L’information géographique, volume 15, n°1, 1951. pp. 14-18. ↑
- Pujoulx Jean-Baptiste, Paris à la fin du XVIIIe siècle, Mathé, an IX – 1801, p. 98 ↑
- Conchon Anne, Paris et les transports sous la Révolution In : À Paris sous la Révolution : Nouvelles approches de la ville, Éditions de la Sorbonne, 2008 ↑
- Bienaymé Gustave, Le coût de la vie à Paris à diverses époques. Moyens de transport publics, Journal de la société statistique de Paris, tome 42 (1901), p. 293-310 ↑
- Masson, p. 257 ↑
- Lentz Thierry, Les relations franco-espagnoles. Réflexions sur l’avant-guerre (1789-1808), Revue du Souvenir Napoléonien, 399, 1995 ↑
- D’après Masson, passim: Mendouze fut guillotiné le 14 prairial an II (2 juin 1794) ; Baudry, le 24 messidor (12 juillet) ; Jozeau, le 8 thermidor (26 juillet) ↑
- A. diplo., personnel, Goffinet ↑
- Almanach national de France, an II, Testu, 1793, p. 393 ↑
- Miot, p. 39 ↑
- Bertrand Barère, Mémoires, Meline, 1842, p. 145 ↑
- Miot, p. 49 ↑
- Miot, p. 48 ↑
- Montbas Hugues de, « Robespierre et les Bonaparte vus par le comte Colchen », Revue des Deux Mondes, 15 septembre 1952, p. 336 ↑
- Baillou, p. 292 ↑
- A. diplo., Comptabilité 1661-1911, Carton 12 ↑
- Blanc Olivier, Les hommes de Londres, histoire secrète de la terreur, Albin Michel, 1989, p. 38 ↑
- Miot, p. 50 ↑
- Istria Simon, La vie de Philibert Buchot, La Révolution française : revue historique, Charavay frères, janvier-juillet 1913, Tome 64, p. 311-326 ↑
- Masson, p. 313 ↑
- Recueil des actes du Comité de salut public, 12, PUF, 1951, p. 436 ↑
- Cité dans Thuillier Guy, Témoins de l’administration, Berger Levrault, 1967, p. 37 ss ↑
- Recueil des actes du Comité de salut public, 14, PUF, 1951, p. 54 ↑
- Masson, p. 318 ↑
- Miot, p. 53 ↑
- Miot, p. 55 ↑
- Kawa Catherine. Les ronds-de-cuir en Révolution: les employés du ministère de l’Intérieur sous la première République : 1792-1800. Éd. du CTHS, 1996, p. 290 ↑
- Kawa Catherine, Dictionnaire biographique des employés du ministère de l’intérieur de la première république (en ligne), annexe de l’ouvrage cité Les ronds-de-cuir en Révolution ↑
- Lamare, Le républicain français, 10 avril 96. (Également publié dans d’autres journaux). ↑
- Kawa, Dictionnaire biographique ↑
- Pujoulx, p. 20 ↑
- Kawa, p. 85 ↑
- Pujoulx, p. 52 ↑
- Durency, Changement de domicile, de l’impr. de l’auteur, sans date ↑
- Ordonnance burlesque du gouvernoire de la République iroquoise, traduite en français par Dulys, grammairien, Rue de la Liberté, N.° 36, s. N., s.d. ↑
- Waresquiel, Emmanuel de, Talleyrand : le prince immobile, Fayard, 2003, p. 217 ↑
- Bruley Yves, « The Napoleonic diplomatic corps », Napoleonica. La Revue, 2009/1 (N° 4), p. 30-49 ↑
- A. diplo., comptabilité, vol. 20 ↑
- Baillou, p. 390 ↑
- Idem, p. 373 ↑
- Idem, p. 465 ↑
- Idem, p. 466 ↑
- Lycée Louis le grand ↑
- AD78, 3E44 175 Minutes Gilles Barat Ricqbourg, 1783, janvier -juin ↑
- Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, I, Pléiade, Gallimard, p. 950 ↑
- Waresquiel, p. 485 ↑
- D’après Mme de Chateaubriand, in Waresquiel, p. 616 ↑
- Eymery Alexis, Dictionnaire des girouettes, ou nos contemporains peints d’après eux-mêmes, JB Imbert, Paris, 1815 ↑